Mémoires de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire. N° 80
Dakar. 1968, 1970, 1975. Trois Tomes. 2377 pages
L'ANCIEN EMPIRE de Samori est remarquable d'emblée par sa grande uniformité humaine, à condition d'en exclure les marches méridionales. Les trois ou quatre ethnies qui l'occupent sont assez proches pour être regroupées sous le nom de Manding et elles forment un seul bloc de l'orée de la grande forêt jusqu'aux rives du désert. Cette situation contraste violemment avec la prolifération ethnique qui règne sur les terres de la Volta et dans ce Pays des Rivières où la forêt guinéenne s'étire le long de l'Océan, jusqu'aux approches du Cap Vert.
Uniformité ne signifie d'ailleurs pas homogénéité. Si nous considérons par exemple l'ethnie malinké, celle qui nous intéresse au premier chef, il est évident qu'elle occupe un territoire immense avec des faciès régionaux peu marqués, et qu'elle se distingue difficilement des Bambara et des Dyula, sinon des Sarakholé. Mais si nous l'étudions avec quelque attention, nous constatons aussitôt qu'elle n'a rien d'homogène, car elle juxtapose en son sein des groupes très divers par la race (soudanais, guinéens, voire éthiopiens) l'origine linguistique (Fula, Senufo, Dyalonké assimilés), la religion (animistes, musulmans), la profession (artisans castés), le genre de vie (paysans sédentaires, dyula, éleveurs).
La singulière uniformité des Malinké va donc de pair avec une grande diversité d'ordre qualitatif. Une structure unique mais d'une extrême complexité occupe ainsi un vaste territoire où elle permet une vie sociale active, faite d'échanges et de relations diverses. Elle s'oppose aux structures relativement simples que l'on observe chez les petites ethnies des zones de morcellement, dont chacune est implantée sur un terroir étroit où elle vit repliée sur elle-même. Baumann l'avait fort bien senti en distinguant dans le cadre des savanes ouest-africaines, les civilisations « néosoudanaises » de celles des « paléonégritiques ». Nous pensons que ces termes sont toujours valables car ils définissent un clivage profond dans la culture, sinon dans la civilisation et leur emploi paraît commode si notre but est de déterminer les facteurs sociaux qui ont préparé ou contrarié l'avènement de Samori.
La civilisation, si nous entendons par là la culture matérielle, a seulement offert aux individus un cadre et des possibilités. Nous l'avons abordée, en étudiant les agricultures, à la suite du milieu naturel qui la détermine partiellement. Elle n'est pas assez diversifiée régionalement et son évolution avant l'ère coloniale n'était pas assez rapide pour modifier le rythme des événements politiques. L'examen rapide de deux exemples spectaculaires, comme les types de construction et les vêtements, nous dira si les techniques traditionnelles se conformaient bien à cette règle d'uniformité.

L'habitat, qui est lié aux conditions politiques et aux formes de l'activité agricole, appartient à des degrés divers au type groupé dans presque toute la région considérée. Les seules exceptions notables, les Kisi et les Sénufo Nafãmbélé, n'ont qu'une portée relative car on peut les interpréter comme des habitats groupés en très petits unités aussi bien que comme habitants dispersés. L'individualité de ces gens ne va pas jusqu'à la maison isolée du lignage lobi, qui est extérieure à notre domaine.
Comme les circonstances historiques peuvent transformer rapidement la forme de l'habitat, celle-ci nous intéresse moins que celle de la maison, qui est plus significative. Quelle que soit l'importance de leurs agglomérations, les pays samoriens se trouvent à cheval sur les deux principales zones architecturales de l'Afrique occidentale, celle de la maison rectangulaire à terrasse du Soudan classique, et celle de la case ronde à toit conique. La répartition des deux types ne coïncide pas avec les grandes provinces culturelles puisque le premier intéresse une grande partie des « paléonégritiques », comme les Lobi, alors que le second est employé par beaucoup de « néosoudanais ». Toutes les grandes ethnies se partagent entre elles et on peut seulement dire que le premier est le plus septentrional. Les Malinke, Bambara et Sénufo du Nord lui sont fidèles alors que leurs frères l'ignorent au sud d'une ligne allant de Kangaba à Bougouni et Sikasso, ainsi qu'il est naturel puisque la terrasse de terre s'accommode mal des climats pluvieux. Il n'est pas question de décrire ici les nombreuses variantes régionales des deux types dont certains traits proposent une vraie leçon de déterminisme géographique, comme la pente du toit de paille qui augmente vers le sud proportionnellement aux précipitations. Inversement, on doit constater la persistance sporadique de la terrasse dans certains grands centres du sud, et particulièrement dans des constructions rituelles, comme les mosquées, qui paraissent mépriser les contraintes du milieu. Ces techniques ne sont pas sans incidence sur le déroulement des guerres, car un dédale de maisons à terrasses constitue toujours une forteresse difficile à enlever.
Notre domaine ne connaît qu'une architecture en bãnko (argile) car les constructions végétales rectangulaires, qui caractérisent ailleurs la grande Forêt, sont absolument inconnues dans celle de la Dorsale. La case ronde en terre règne ici sur l'ensemble des peuples forestiers et les Kru eux-mêmes lui sont fidèles jusqu'à la côte atlantique, du moins à l'ouest du Sassandra.
Il faut s'éloigner vers l'est, dans le Nouvel Empire pour trouver des exceptions à ce tableau si simple telles les curieuses « cases en couronne » des Gã de l'Ano, qui ne sont sans doute pas étrangères aux grandes maisons à impluvium de l'Abrõ. Ces faits aberrants et marginaux peuvent être négligés ici, car ils relèvent d'une autre province culturelle, celle du golfe du Bénin (Atlantique-Est de Westerman).
Si nous considérons à présent les vêtements, qui jouent un rôle capital dans l'ambiance d'une société, et qui en symbolisent les hiérarchies, l'uniformité est encore plus remarquable. La nudité paléonégritique est ici inconnue. Les tabliers de peau persistent jusqu'à nos jours chez quelques vieux Sénufo et ils sont également connus des Forestiers, car les pagnes d'écorce battue ne prennent de l'importance qu'en pays Kru. Au XIXme siècle, la totalité des peuples qui nous occupent cultivaient le coton et pratiquaient le tissage, même s'ils conservaient une civilisation de tradition paléonégritique ou forestière. Ces techniques sont si bien adaptées que divers styles de tissage, remarquables par la beauté de leurs motifs symboliques, se sont développés chez certains « barbares » du Sud, comme les Guro, les Kpèllè (Guerzé) ou les Mèndé. La tradition artisanale des Manding domine cependant partout, caractérisée par des combinaisons de bandes, dont les couleurs alternées, fournissent des étoffes rayées en damiers. Les modes du Soudan se sont imposées et celles des hommes évoquent une lointaine ascendance maghrébine, avec le dorokè, ce grand vêtement de dessus, que les Français appellent boubou, le kursi ou pantalon à large fond, les sandales à pouce séparé (samara) ou les mules en cuir (mugè, darabu pour les femmes). Le costume féminin, qui est au contraire une création purement africaine, comprend deux pagnes superposés enroulés sur la taille, et tombant, le premier jusqu'aux genoux, le second jusqu'aux chevilles Un troisième les complète pour couvrir le buste et soutenir le bébé dans le dos, mais il peut être remplacé par une blouse à manches rappelant celle des hommes (ntara). Le voile de tête est un luxe et il ne cache jamais la face de ces épouses qui ignorent le harem. En pays Sénufo et en forêt, elles se contentent souvent d'un cache-sexe, comme les hommes eux-mêmes, mais seulement pour le travail.
Nous ne nous aventurerons pas dans le domaine complexe des coiffures et des parures qui révèlent souvent les valeurs d'une culture 1. Les couvre-chef, bonnets divers ou turbans, distinguent les animistes des musulmans, tandis que le vaste chapeau conique du nord s'était imposé jusqu'aux lisières de la forêt, à tous les hommes qui affrontaient de longues marches au soleil.
Il serait vain de passer maintenant à la description minutieuse des techniques, qu'elles soient celles tisserand, du teinturier ou du forgeron. Elles sont étroitement associées au commerce dont nous parlerons plus loin et leur examen confirmerait l'unité fondamentale de cette civilisation. Pour trouver des éléments significatifs, il convient donc de nous placer désormais sur le terrain moins large de la culture. Puisqu'il s'agit de Samori, l'étude du milieu humain sera nécessairement centrée sur l'ethnie néo-soudanaise dont il est issu, à savoir celle des Malinké.
Le mot d'ethnie nous a placés d'emblée dans le domaine de la vie sociale, si bien que l'étude des races ne nous retiendra guère. Il arrive parfois, en Afrique plus qu'ailleurs, qu'un groupe humain soit caractérisé par un type physique original, mais il s'agit alors d'éléments résiduels ou isolés par un genre de vie spécial, comme les chasseurs Boshimans ou pygmées. Si l'on néglige ces cas marginaux on constate la même discordance entre race et culture que dans le reste de l'humanité. Les Peuls en sont un bel exemple. Ils gardent leur type racial « éthiopien » tant qu'ils sont pasteurs nomades, mais ils parlent une langue ouest-atlantique. Dès qu'ils se sédentarisent, le métissage diversifie à l'extrême leur apparence physique, tandis qu'ils subissent volontiers une nouvelle mutation linguistique, comme ces Fula du Wasulu, qui gardent leur fierté ethnique mais ont adopté la langue et la civilisation de leurs voisins bambara 2. Nous les rencontrerons souvent au fil de ce récit.
L'histoire est donc le fait des ethnies, non des races. Celles-ci peuvent cependant nous éclairer sur le passé des peuples au sein desquels elles se mêlent. La persistance de tailles relativement hautes chez les Malinké du Sud étend le type « soudanais » jusqu'au 8ème parallèle, creusant un large saillant entre le Fuuta-Dyalõ et le Sénufo méridional, peuplé d'hommes relativement petits On peut y voir une confirmation des traditions orales qui décrivent les invasions du XVIme siècle comme une migration massive Des traditions du même type se rencontrent chez les Kuranko ou les Konyãnké, enfants perdus des Malinké, dont ils ne se distinguent guère sur le plan culturel. La forte diminution de la taille et l'augmentation de l'indice kormique prouvent pourtant ici que les conquérants ont été assimilés socialement par leurs voisins Kisi ou Toma, tout en maintenant leurs traditions culturelles.
Si nous demeurons sur le plan de l'anthropologie 3, l'uniformité humaine de l'Empire samorien n'est pourtant pas aussi nette qu'on vient de le dire. Il est vrai que tous ses habitants appartenaient à la race mélano-africaine, si l'on excepte quelques Maures isolés, car les Fula, et surtout ceux du Wasulu, sont tellement métissés qu'on ne peut plus les classer dans la race « éthiopienne ». Les individus au teint clair sont très rares parmi eux, mais on y trouve encore des hommes remarquables par leurs membres graciles, leur face allongée et leur nez étroit. Ils sont cependant en minorité au sein d'une masse qui ne se distingue guère des Bambara voisins.

Nous pouvons donc admettre que tous les sujets de l'Empire étaient de race noire, ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient un type physique homogène. Les conquêtes de Samori s'étendaient en effet de part et d'autre du clivage longitudinal qui sépare, en Afrique occidentale, le type soudanais du type guinéen. On oppose traditionnellement l'homme des savanes, grand, maigre, les jambes longues, le mollet mince, le teint sombre, à celui des forêts, petit et trapu, souvent rond, les jambes courtes et fortes, le teint variable et souvent clair. Le professeur Pales a prouvé que cette opposition, d'ailleurs évidente, doit être nuancée. En combinant la stature, l'indice céphalique et l'indice kormique, il a pu mettre en évidence quatre sous-races noires en Afrique occidentale
Trois d'entre elles nous intéressent ici 4 .
En se limitant aux caractères retenus par le professeur Pales, les Soudanais sont des dolichocéphales de grande taille (hypsisomes) et pourvus de jambes longues par rapport au tronc (brachykormes). Les Soudano-guinéens, qui font la transition, se distinguent des précédents par des jambes plus courtes (métriokormes) et une taille un peu plus faible, mais ils restent hypsisomes et bien entendu dolichocéphales comme presque tous les Africains de l'Ouest. Les Guinéens enfin, sont des dolichocéphales, de taille beaucoup plus petite (mésosomes) et ont généralement des jambes courtes (métriokormes).
Le profane confond cependant les Soudano-Guinéens avec les Soudanais, conformément au cliché traditionnel. Le professeur Pales classe les Malinké dans le premier groupe et les Bambara dans le second mais cette opposition n'est pas sensible à l'observateur. Il s'agit en fait de groupes de transitions souvent très proches des indices choisis comme seuils. Il est d'ailleurs possible que Pales n'ait pas distingué assez nettement les faciès régionaux, ce qui est nécessaire pour des peuples occupant d'aussi vastes espaces 5. Des groupes ethniques relativement étroits, comme les Kisi, ne présentent pas eux-mêmes un aspect homogène car le type soudanais, relativement fréquent chez ceux de Kissidougou, est tout à fait étranger à ceux de Guékédou.
Constatons simplement que les petits hommes trapus, au teint souvent rougeâtre ou cuivré, plutôt que noir, prédominent chez les Kisi comme chez les Toma, les Guerzé, les Dã ou les Guro. On les retrouve chez les Kuranko et les Konyãnké et aussi, à première vue, dans le Mau et le Worodugu. Dans les régions préforestières, le type soudanais devient plus fréquent, tout en restant minoritaire. Cette proportion s'inverse au coeur du pays malinké, d'Odienné à Kankan, mais on y trouve toujours quelques « Guinéens ». Ceux-ci ne sont même pas étrangers au Wasulu et au sud du pays Bambara 6.
Samori a commence sa carrière au Konyã, pays d'hommes de petite taille, d'où étaient issus la plupart de ses ancêtres 7. Il était pourtant lui-même un bel exemple de « Soudanais » et ce type reste fréquent dans sa famille, non seulement parmi les dyula, mais parmi les cultivateurs animistes. Ceci nous gardera de toute généralisation abusive.
Les diverses « races » coexistent à l'intérieur de chaque ethnie, et cela est particulièrement vrai du monde malinké où une vie de relations intenses et l'action séculaire du commerce à longue distance a largement brassé les hommes.
On peut cependant admettre que beaucoup des premiers compagnons de Samori étaient de race « guinéenne » et ce stock sera d'abord renforcé par le ralliement des Kuranko, de certains Kisi ou Toma, et enfin, plus tard, du Mau. Par contre, de 1872 à 1893, le conquérant dominera des pays occupés presque exclusivement par des Malinké ou Bambara, c'est-à-dire des Soudano-Guinéens ou Soudanais typiques. Une forte majorité de ses hommes proviendra de ce stock. Le sofa de tradition populaire est un grand Soudanais efflanqué, maigre et infatigable, comme les conquérants qui submergèrent la Haute Côte d'Ivoire en 1894.

C'est seulement après cette date et dans la mesure où il recruta sur place que Samori rassembla autour de lui des types exotiques, comme les Kulãngo, mais il est douteux qu'il se soit avisé de la prédominance des brachycéphales chez ce peuple.
B. LE MONDE DES LANGUES 8
Cette diversité raciale toute relative n'avait évidemment aucune importance aux yeux des intéressés. Il est probable qu'ils ne la remarquaient guère. Les facteurs de division ou d'union qui comptaient pour eux, étaient naturellement d'ordre culturel et nous placerons les langues au premier rang. En Afrique plus qu'ailleurs, toute culture s'incarne en effet dans une langue, et bien qu'elle ne soit écrite qu'accidentellement, c'est elle qui donne à chaque groupe humain son nom et la première conscience de son identité. L'administration coloniale ne s'y est pas trompée : elle a définit la « race » de ses administrés d'après leur langue maternelle.
C'est justement sur ce plan que l'homogénéité de l'Ancien Empire est la plus remarquable. Nous sommes en effet au coeur d'un immense territoire où l'on parle, sous des formes dialectales très peu divergentes, une langue véhiculaire unique. Ses usagers lui donnent il est vrai des noms divers, mais nous la qualifierons de manding 9, d'après son dialecte occidental, le mãndunka de Casamance et de Gambie qui a été le premier connu des Européens. Il est vrai que ce dialecte est assez aberrant et Houis lui réserve le nom de « langue manding » pour souligner son autonomie. Nous ne le suivrons pas, sans nier que notre solution peut être contestée. En l'absence d'une convention généralement acceptée, il faut bien un nom pour désigner cet ensemble de parlers remarquablement homogènes qui assurent une intercompréhension immédiate sur plus de 1.200 kilomètres d'ouest en est, de la Gambie à Djenné, Bobo Dioulasso et Kong, et près d'un millier du nord au sud, de Sokoro aux franges de la forêt (Kissidougou, Beyla, Touba, Séguéla, Mankono) 10. Langue vernaculaire à l'ouest du Bandama, le manding est véhiculaire à l'est jusqu'à la Volta, sans parler des nombreux îlots dyula où il est d'usage quotidien. Bien sûr, cette uniformité est relative. En dehors du mãndunka, très particulariste, on peut distinguer des grands blocs dialectaux, dont les principaux sont :
Tous ces dialectes, peu diversifiés, couvrent d'immenses étendues et il faut aller jusqu'aux franges forestières, de Beyla à Mankono, pour observer un certain morcellement dû sans doute à des substrats considérables et à un isolement relatif, vieux de plusieurs siècles.
En dehors de ces exceptions, le fait massif et indiscutable reste l'homogénéité surprenante de la langue. Cela est particulièrement net dans le bassin du Haut Niger, qui est au coeur de notre enquête. Les parlers malinké classiques, qui s'échelonnent de Bamako à Siguiri et Kouroussa, ne présentent que d'infimes variantes tandis que les dialectes du Sãnkarã et de Kankan s'en distinguent à peine. Ce dernier a connu une grande fortune en raison de l'hégémonie commerciale de la métropole dyula. Ceci ne doit pas nous dissimuler le fait que les dialectes ruraux qui s'étendent plus au sud jusqu'à la Forêt ne s'en différencient guère. Bien que les locuteurs, comme on pouvait s'y attendre, insistent sur des différences subtiles, on a grande peine à isoler quelques traits distinctifs.
Cette uniformité linguistique est assez exceptionnelle en Afrique 11, bien que le mosi et le hausa, avec leurs dialectes fort homogènes, en offrent d'autres exemples. Le dernier intéresse à vrai dire une population bien plus considérable que le manding mais aucun ne couvre un aussi vaste territoire.
Les linguistes ne peuvent expliquer une situation aussi remarquable qu'en admettant qu'une telle langue s'est répandue à une époque assez récente par migration et diffusion. La géographie des dialectes, suggère que son berceau se trouvait dans la vallée du Niger, de Siguiri à Ségou, de part et d'autre du clivage majeur Maninka-Bammana. Il est dès lors tentant de lier son expansion à celle de l'Empire du Mali, du XIIIme au XVme siècle, et toutes les traditions confirment cette hypothèse.
Ce n'est d'ailleurs là qu'un aspect d'un problème plus vaste qu'il ne saurait être question de traiter ici. Rappelons seulement que si le manding est une langue de premier plan, il est solidaire d'un cortège imposant de parlers d'importance très variable qui parsèment un espace immense, allant des bords de l'Atlantique au Moyen Niger vers Busa et du Hodh saharien jusqu'aux approches du Golfe de Guinée (Oumé, Côte d'Ivoire) 12. Leur parenté génétique étant hors de doute, ils forment une famille que nous désignerons par le nom déjà traditionnel de Mãndé. Des peuples aussi divers que les Azer des oasis mauritaniennes et les Gagu de la Grande Forêt, parlent ainsi des langues apparentées, ce qui pose des problèmes difficiles. L'archéologie et l'ethnobotanique commencent cependant à nous éclairer. Il paraît vraisemblable que l'expansion des langues mandé est à rapprocher de la cristallisation d'un berceau d'agriculture sur le Haut Niger, au deuxième millénaire avant notre ère 13. La supériorité initiale de cette culture serait due à la domestication du riz africain (Oriza glaberrima). L'acquisition de la métallurgie du fer l'aurait renforcée avant le début de notre ère, bientôt relayée par l'extraction de l'or, qui allait animer le commerce transsaharien. Au long de plusieurs millénaires la famille mãndé, en mutation constante, aurait donc été le principal épicentre culturel de l'Afrique occidentale.
De nombreuses ondes de choc en sont issues et elles se sont recouvertes successivement, si bien que nous devons en bonne logique trouver à la périphérie des témoins des plus anciennes. Il semble bien que ce soit le cas si l'on considère les Gagu du Bandama et les Gã du Comoé, qui sont des Forestiers encore mal dégagés d'une économie de chasse et de cueillette. On songe aussi aux Bobo de Haute-Volta (Burkina Faso), des cultivateurs traditionalistes qui méritent pleinement l'épithète de paléonégritiques. L'historien attend du linguiste une description génétique de leurs langues, qui permettrait d'isoler ces vagues successives. Delafosse l'a tentée dès le début du siècle, mais son effort était prématuré. Impressionné par le fossé culturel qui sépare les Manding des peuples de la Forêt, il pensa résoudre le problème en distinguant, selon le mot signifiant dix, les langues mãndé-fu, archaïsantes, parlées par les ethnies périphériques les langues mãndé-tã, innovatrices, au centre desquelles se trouve le manding.
L'introduction du susu (Sosokui) dans le premier groupe démontre l'imprudence d'une classification fondée sur un trait unique. Delafosse simplifiait excessivement une réalité complexe et recourait à des facteurs culturels pour mener une analyse qui aurait dû rester d'ordre purement linguistique.
Le R. P. Prost, puis Maurice Houis, ont montré récemment que ce clivage général des langues mandé était sans fondement. De son côté, le professeur Welmers prépare une reconstitution du mãndé commun et nous propose déjà une généalogie de cette famille linguistique, assortie de dates de fission calculées selon les méthodes de la glottochronologie 14. Beaucoup de linguistes doutent que cette technique puisse fournir des valeurs absolues mais il suffit pour notre propos qu'elle donne un ordre de grandeur susceptible de situer les langues les unes par rapport aux autres.
La classification de Welmers est révolutionnaire en ce sens qu'elle distingue deux groupes de langues mandé, occidental et oriental, qui auraient divergé peut-être 1.600 ans avant notre ère, et qui comprennent tous deux des Soudanais et des Forestiers. Le groupe oriental a dû s'écarter assez tôt du berceau nigérien et se serait scindé à son tour en deux branches, vers le début de notre ère. La première, localisée dans la savane, comprend des langues de peuples paléonégritiques, comme les Busa du Nigeria (Borgu), ainsi que les Bisa, Samagho et Sãmblé de Haute-Volta et du Mali. Le Bobo de Bobo-Dioulasso s'y rattache peut-être, bien qu'il soit particulièrement aberrant et il n'est pas exclu qu'on doive y inclure le dogon.
La seconde branche couvre les Forestiers de l'Est, surtout ceux du Liberia et de Côte d'Ivoire. La parenté du kwéni (guro) avec le wen (tura) 15 et le dã (ou gyo) a été établie depuis longtemps, ainsi que celle, moins étroite du manã (manõ). Le gagu, le gã et le nwã (ouan) représentent peut-être une vague plus ancienne et ont une position à part 16.
Quant au groupe occidental, qui nous intéresse plus directement, il se serait scindé dès 500 avant notre ère en deux branches nord et sud. Cette dernière regroupe le reliquat des langues forestières. de Guinée et du Libéria : kpèllè (guerzé) avec son dialecte konon 17, toma et gbândi. Le mèndé et le loko de Sierra Leone se seraient séparés plus tard de la souche 18. Ces langues ont développé des mécanismes originaux, comme la mutation des consonnes initiales, qui les opposent radicalement à celles des Forestiers de l'Est, ainsi que le Père Prost l'a signalé depuis longtemps. Le fait nouveau est qu'on les groupe désormais avec les langues mãndé de l'Ouest, particulièrement le manding, qui domine la branche nord correspondante.
En faisant abstraction des nappes les plus anciennes et en nous limitant aux franges forestières 19, on peut déjà discerner quelques grandes lignes. Les langues de la Forêt, de l'un et l'autre groupe, sont séparées du manding depuis très longtemps et les peuples qui les parlent n'ont rien à voir avec l'Empire du Mali. De nombreux indices attestent cependant qu'ils n'ont pas évolué dans leur terroir actuel, ne serait-ce que les traditions qui permettent de suivre leurs mouvements, au cours des derniers siècles, depuis les savanes sub-soudanaises jusqu'au coeur de la Forêt . Nous ne sommes d'ailleurs pas en état de reconstituer leur civilisation ancestrale qui a nécessairement subi des mutations profondes en s'adaptant à ce nouveau milieu, et que l'absorption de substrats divers a certainement diversifiée. Si nous passons en revue les principaux traits culturels de ces peuples, nous constatons qu'ils se retrouvent presque tous chez leurs voisins de langue kru (Gèrè et Bété) ou mèl (Kisi, Témné) 20. Cette assimilation au milieu forestier a été telle que les clivages culturels et linguistiques se trouvent en discordance totale. Malgré une lointaine parenté dont ils ne sont plus conscients, les Mandé de la forêt s'opposent radicalement à leurs voisins des savanes, qui représentent la dernière vague linguistique, celle des Manding. Ceux-ci sont souvent considérés comme des ennemis puisque le refoulement des Forestiers a été leur oeuvre et que la tradition en conserve toujours le souvenir.
Nous sommes irrésistiblement poussés à ordonner toute la famille mãndé par rapport à cette dernière vague qui est d'époque historique et dont le triomphe contemporain nous inspire un véritable vertige de finalité. Son importance est évidente puisqu'elle couvre dans l'ouest toute la zone des savanes, qu'elle a servi de véhicule aux grandes civilisations médiévales et que les principaux agents de l'Islam moderne lui appartiennent. Elle est au coeur de notre enquête qui va abandonner désormais les peuples marginaux à l'ombre de la grande sylve qui les a accueillis.
Mais voici que nous péchons déjà par simplification abusive en parlant d'une vague, alors qu'on discerne plus ou moins nettement une série d'ondes successives. Si le berceau du Manding, que nous situons sur le Haut Niger, est marqué par le clivage maninka-bammana, un clivage bien plus ancien en aurait séparé les parlers susu et dyalonké, vers le début de notre ère. Cet ensemble dialectal, dont Houis a montré la forte personnalité, garde cependant des connexions étroites avec les autres parlers du groupe, particulièrement le soninké et le mandunkã ou malinké occidental 21. Il occupait anciennement la haute vallée du Sénégal, où il s'était peut-être cristallisé plus tardivement, le massif du Fuuta-Dyalõ et le Niger en amont de Siguiri. Depuis le XVIIIme siècle, les Peuls ont refoulé les Susu sur la Côte des Rivières où ils ont absorbé des parlers de la famille mél, tandis que les Dyalonké, pris en tenaille entre ces conquérants et les Malinké du Niger ont eu tendance à abandonner leur langue. Les orpailleurs du Burè et du Bidiga ont adapté le malinké sans doute dès le XVIIIme siècle. Le dyalonké tient encore la rive gauche du haut fleuve, mais a perdu les orpaillages du Huré au XIXme siècle, puis le Baléya et le Ulada au XXme 22. Il cède du terrain au Firiya (cercle de Farana) et ne se maintient avec vigueur qu'au Solimana à cheval sur la Guinée et la Sierra Leone 23. On le trouve encore dans les hauts massifs gréseux de la rive gauche du Bakoy (Menyen, Kulo) et sur les marches septentrionales du Fuuta-Dyalõ (Wõntofa et Sangala). Ce fut sans doute la langue des premiers orpailleurs du Soudan occidental, qui ont dû vivre et la seconde de proto-manding.
Les Manding proprement dits, qu'il nous reste à examiner, doivent être à leur tour scindés en plusieurs strates, sans doute au nombre de deux. Nous qualifierons la première de pré-manding et la seconde de proto-manding.
Le pré-manding s'incarne dans le soninké 24 dont la forme ancestrale fut la langue de l'Empire du Ghana. Il s'est individualisé dès le premier millénaire et ses locuteurs, qui forment le noyau originel des dyula, ont mis en place le premier réseau africain de commerce à longue distance. lI s'agit donc d'une vague ancienne et actuellement décroissante. Cette langue, jadis glorieuse, n'est plus employée que sur le Sénégal de Bakèl (Guoye) et au Sahel de Nioro (Bakunu). Plus au nord elle a reculé devant l'arabe des Maures (Azer) et sur le Niger au profit du manding proprement dit. Les dyula, qui incluent les Turè, ancêtres de Samori, l'ont partout abandonnée, ce qui nous permet de la négliger désormais.
Le proto-manding ou vieux manding évoque par contre l'Empire du Mali et sa parenté avec les dialectes malinké et bambara est extrêmement étroite. Il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une langue particulière, comme le soninké. L'unité intrinsèque du pré-manding n'est d'ailleurs nullement évidente. Il comprend en effet deux groupes dialectaux, séparés par un bon millier de kilomètres et utilisés par les locuteurs de civilisations très diverses. Dans l'ouest ce sont les Kono sur les hauts plateaux de Séfadu (et les Vai ou Gallinas de la côte entre Moa et Lofa, en Sierra Leone et Libéria). Dans l'est, nous trouvons les Ligbi et Hwéla sur la Volta Noire (région de Bondoukou et zone avoisinante du Ghana) et en outre différents parlers utilisés par des castes ou des villages isolés (Numun du pays Kulango, Blé de Banfora. Dyèli de Korogho). Dans le premier cas, un isolement séculaire en milieu forestier et l'action d'un substrat très important, a permis la cristallisation de deux peuples originaux. Dans l'est, les relations actives dues au commerce de l'or et l'arrivée de nouvelles vagues manding ont maintenu une grande fluidité et nous n'avons affaire qu'à des parlers résiduels en voie d'absorption.
En l'absence d'une étude linguistique sérieuse, il incombe à l'historien de construire une hypothèse rendant compte de la parenté de ces dialectes 25. Tauxier avait imaginé une migration d'est en ouest, frangeant toute la Forêt. Un mouvement d'ouest en est serait plus conforme au passé de ce pays et j'y ai cru un instant car divers indices permettent en effet de penser que des parlers de ce type ont existé il y a quelques siècles dans la zone intermédiaire. Les deux îlots contemporains sont pourtant si divergents qu'il faut chercher une autre solution. Le groupe kono-vai est intimement uni aux dialectes de type malinké, et le groupe ligbi-hwéla à ceux de type bambara. Il est difficile de ne pas mettre ceux-ci en rapport avec l'ouverture des mines de Bégho et la fondation de Djenné. Les traditions lient la migration des Konor et des Vai à celle des Kamara qui ont contribué au peuplement du Haut-Niger et du Konyã. Il s'agirait donc de deux mouvements distincts, distants d'un siècle au moins et issus de deux sections différentes de la vallée du Niger. La divergence des deux groupes serait alors naturelle, d'autant plus qu'ils ont absorbé des substrats différents, kisi, ou plus généralement mèl dans l'ouest, guañ et peut-être sénufo dans l'est.
Leurs ressemblances supposent un ancien état du manding, commun aux formes ancestrales du malinké comme à celles du bambara. Des traits archaïques se seraient fixés dans ces deux régions périphériques, tandis que la langue accélérait son évolution dans la vallée du Niger, théâtre d'un histoire active, dont les innovations gagnaient rapidement la plupart des dialectes.
Si cette hypothèse est fondée, nous n'aurions pas affaire à une langue originale mais à deux ensembles de parlers mêlant des traits de conservatisme à de fortes divergences dues au substrat. Leur confrontation en regard des dialectes proprement manding, nous permet peut-être d'évoquer la langue contemporaine de la grandeur du Mali.
L'élimination des vagues successives qui ont formé le monde mandé nous laisse en présence de la vaste zone centrale, ce domaine proprement manding dont l'étonnante uniformité nous a servi de point de départ. Nous négligerons désormais ses provinces occidentales, de Kita à Bafoulabé, Kayes et la Casamance, car elles sont géographiquement étrangères à l'aventure de Samori.
Les pays du sud restent seuls en cause et en particulier les régions de peuplement malinké dont nous avons déjà indiqué les divisions géographiques. Il reste à en préciser la fragmentation dialectale car elle devrait permettre de contrôler les traditions orales relatives au peuplement de la région. Elle intéresse surtout le problème des migrations malinké sur la frange forestière, entre Sassandra et la Volta, car deux courants s'y mêlent confusément, le premier issu du Haut Niger et le second de Djenné par Kong.
La chose n'est pas facile car l'homogénéité de la langue a découragé les études de dialectologie. Delafosse nous a pourtant fait connaitre le parler de Kong, dès 1901, dans un travail d'ailleurs assez médiocre. Les missionnaires protestants, de leur côté, nous donnent des lumières sur le dialecte de Kankan, celui des fameux Maninka-Mori. Ces deux pôles sont essentiels car ils permettent des comparaisons fructueuses, mais un pays immense demeure dans l'obscurité. Nous y avons remédié dans une certaine mesure en collectant un assez grand nombre de vocabulaires, dont les éléments culturels mettent en évidence des courants de civilisation. Ils ne remédient pas au manque d'études descriptives car il faudrait des données plus précises pour dessiner une carte dialectale. Du Haut-Niger au Rokèl et au Sassandra on ne trouve en effet qu'une infinité de parlers très voisins qui assurent de proche en proche d'insensibles transitions. Dans le nord, on distingue cependant des clivages assez nets. Le maninkakã proprement dit s'étend de Bamako à Siguiri et Kouroussa. A l'est le cours de Sankarani, et au nord les monts du Manding le séparent nettement du bambara tandis que le dialecte de Nyagasola (Kèndé, Mãndé) appartient déjà au domaine occidental au même titre que celui de Kita :
| r | devient | t |
| koro | devient | koto |
Vers l'ouest, le Bakoy marque la limite du dyalonké, le maninka ayant conquis sur cette langue le Burè et le Bidiga. Entre le Niger et le Tenkiso le même phénomène était en cours à la fin du XIXme siècle dans le Hamana et le Ulada si bien que le sous-dialecte de Kouroussa (Hamana) était déjà véhiculaire jusqu'aux frontières du Fuuta-Dyalõ, et même jusqu'aux anciens orpaillages du Huré, sur le Haut Kaba.
Vers le sud, au contraire, on ne peut fixer aucune limite précise. L'influence de Kankan a été si forte, surtout le long des routes commerciales, qu'il paraît impossible d'opposer son parler à celui des Maninka-Mori à ceux du Sãnkarã et du Torõ. Le premier s'étend des rives du Milo jusqu'au Haut Niger qui le sépare nettement des Dyalonké du Firiya. Le second règne du Niger au Sãnkarani où commence le bambara du Wasulu (cercle de Kankan). Le sãnkarã-kã se distingue, enfin légèrement du kurãnko-kã, plus méridional, qui occupe un territoire en lanière étiré de la Rokèl jusqu'au Milo. Nous atteignons cette fois les frontières des Manding car le Kuranko touche de trois côtés à des parlers allogènes. Le dyalõnké du Solimana et le limba le limitent dans l'ouest, tandis que le témnè, le kono, le kisi et le toma s'échelonnent sur son flanc méridional (Sierra Leone: district de Koinadugu, fractions des cercles de Farana, Kissidougou et Kankan)
Le lelé-kã s'en sépare seulement par quelques particularités de vocabulaire, bien que la civilisation et le physique de ses locuteurs soient typiquement « forestiers ». Il occupe un véritable doigt de gant qui s'enfonce en terre Kisi du haut Nyãdã jusqu'à la Malo, un sous-affluent du Makhona (cercles de Kissidougou et de Guékédou).
A l'est du Kuranko, le torõn-kã cède progressivement la place au konyã-kã, parler maternel de Samori. Celui-ci s'étend du Milo au Tyemba (Sassandra) couvrant tout le pays de Beyla et une grande partie de celui d'Odienné 26. Vers le sud, il pousse de nombreuses enclaves dans le Toma (Tukoro) et jusqu'en territoire libérien (Gbuni). Sa limite avec le guerzé, de Boola au Gwen, est fort nette, ainsi que celle qui le sépare du maukã sur le Fèréduguba (Bagbè) et jusqu'au confluent du Sassandra. Vers l'est, les Sénufo du Noolu (cercle d'Odienné), étant des Voltaïques, lui opposent une frontière majeure, prolongée par le clivage bambara qui va de Tyémé à Samatigila et Maninyã à travers les terres du Kabasarana.
Les parlers que nous venons d'énumérer sont d'une uniformité remarquable. Ce sont de simples variantes du dialecte de Kankan et l'usage commun les confond naturellement sous le nom de maninka-kã. Il est par contre surprenant que ce nom soit appliqué aux dialectes de la frange forestière dont nous avons déjà souligné le morcellement et la relative diversité, exceptionnels pour le domaine manding.
Le premier d'entre eux est le mau-kã qui occupe autour de Touba (Côte d'Ivoire) une région incrustée d'îlots Dã 27. Il s'étend jusqu'à la rive ouest du Sassandra et pousse des enclaves dans les montagnes du sud jusqu'aux abords de Man. En raison de sa forte nasalisation il est difficilement compréhensible aux autres Malinké.
Du Sassandra au Marawé, on trouve le
Ces trois formes de maninka sont très aberrantes du fait d'une prononciation extrêmement contractée qui dénote sans doute des influences Dafiñ (cercle de Dédougou - Haute-Volta) 28.
La vallée du Béré marque enfin un isoglosse. Le koro-kã qui commence sur la rive orientale est identique au dyula de Kong : on ne le qualifie plus de maninka. Il domine jusqu'au Bandama et a supplanté le zerma dans l'agglomération de Marabadyasa. On ne peut l'isoler des parlers très uniformes qu'on rencontre à Bobo, Bouna et Bondoukou, et dans tous les centres musulmans jusqu'à la Volta Noire. Les dialectes dyula sont assez proches du bolõ (cercle d'Orodara), lui-même voisin du bambara du Kala, entre Djenné et Ségou. Ils dénotent cependant de fortes influences Dafiñ (cercles de Tougan et Dédougou), bien que la contraction des mots y soit moins marquée (bolo et non boo pour main).
De malinké en dyula nous venons de nous risquer sur les terres lointaines qui ne seront soumises à Samori qu'après 1892. Nous avons ainsi contourné le domaine des Bambara qui sont les moins mobiles des Manding. Leur dialectes nous retiendront peu car ils occupent une position excentrique par rapport à la zone étudiée et n'ont joué qu'un rôle passif dans la construction de l'Empire. Ce sont pourtant les mieux connus de toute l'aire linguistique, et aucune divergence fondamentale ne les oppose au malinké. Ici encore, les isoglosses sont difficiles à tracer en raison d'une infinité de transitions sur un fonds d'intercompréhension immédiate. Sans nous écarter des pays samoriens entre Sãnkarani et Bagoé, les dialectes de Bamako (rive droite), du Dyitumu, du Banã, du Baninko et du Gbãndyé se fondent l'un dans l'autre jusqu'au point où ils butent devant Tyõni et Tengréla, sur la frontière fort nette du sénufo. Plus à l'ouest, dans les hautes vallées du Sãnkarani et du Baulé, le gwalala-kã, langue des Wasulu. présente une famille de sous-dialectes fort originaux. Malgré un certain nombre d'accidents phonétiques, ils restent parfaite compréhensibles, mais leurs locuteurs n'emploient jamais le nom de bammana-kã pour les désigner. L'originalité ethnique et l'orgueil naturel des Fula mandinguisés suffisent à expliquer ce particularisme.
Notre périple s'achève ainsi et il est significatif que nous n'avons pas éprouvé le besoin de signaler des langues non mandé. Pour trouver celles-ci dans les domaines de Samori, avant 1893, il fallait en effet chercher minutieusement dans quelques marches lointaines et peu accessibles. Quelques lignes y suffiront.
La famille mèl, caractéristique des rivières du sud, était surtout représentée par le kisiyé, localisé dans un domaine dont les franges du nord, ralliées au conquérant dés 1871 allaient rester fidèles jusqu'en 1893. Cette langue à classes très originale est une butte témoin cernée de toutes parts par les idiomes mandé. Elle n'a joué aucun rôle dans l'entourage de Samori. Deux autres langues mél, le limba et le tèmné, sont parlées dans les marches occidentales de l'Empire, qui n'ont connu qu'une occupation éphémère de 1884 à 1888.
Malgré les bonnes relations de Samori avec le Fuuta-Dyalõ, le Pular était inconnu chez lui, ou du moins était pratiqué seulement par quelques individus comme les Toucouleurs fuyant Ségou en 1890. Tous les groupes Fula de l'Empire avaient abandonné cette langue depuis un ou deux siècles.
La famille voltaïque enfin, n'était représentée que par les Sénufo de Tyõñi et Tengrèla, mais il en ira autrement après 1893, car le nouvel Empire sera construit presque exclusivement dans le domaine de ce groupe. En dehors des Gondja, derrière la Volta, et des Abrõ, qui emploient un dialecte ashanti, les nouveaux sujets de Samori parleront essentiellement le syénar (sénufo), sous différentes formes dialectales (kyèmbagha, nafagha, tagwana, dyimini) et plus à l'est le kulango, derrière le Comoé. Ces années d'improvisation n'ont rien de significatif et elles ne peuvent nous éclairer sur les forces au travail dans I'Empire. Et cependant, ici encore, le conquérant s'appuiera de préférence sur les noyaux dyula, ce qui ne lui épargnera pas la trahison de Kong.
Il est donc permis de conclure fort nettement. Samori allait rassembler des territoires dotés d'une homogénéité linguistique qui est exceptionnelle pour l'Afrique, si on néglige quelques marches allogènes, comme le Pays Toma, dont l'Almami parlait d'ailleurs la langue. La nouvelle hégémonie allait donc s'exercer sur des hommes qui employaient presque exclusivement des dialectes manding. La cour adapta naturellement la fameuse langue de Kankan, popularisée depuis longtemps par le commerce et l'Islam, et d'ailleurs peu différente du konyãn-kã maternel du conquérant.
La révolution de Samori, située dans son cadre linguistique, est donc étroitement liée aux milieux de langue manding. Elle est issue de la dernière nappe mãndé, la plus moderne, qui venait de se figer aux XVIme et XVIIme siècles, mais avait régné sans partage durant l'ère impériale du Mali.
Cette homogénéité linguistique n'est nullement démentie par les structures sociales, du moins si nous les considérons sur le plan des principes les plus généraux. Tous les peuples que nous venons de passer en revue sont soumis à un régime patrilinéaire strict. en matière de descendance, de statut, d'héritage et de succession. Des coutumes matrilinéaires apparaissent au sud-est, chez les Sénufo, mais leurs fractions occidentales. Les .seules qu'ait connues Samori avant 1894, sont également patrilinéaires.
Les sociétés organisées sur ce modèle abondent en Afrique et plusieurs de celles qui nous occupent ont fait l'objet d'études approfondies. C'est le cas des Bambara. sinon des Malinké, parmi les Manding, ainsi que des Kisi et des Kpèllè (Guerzé) parmi les Forestiers.
L'unité fondamentale est la famille patriarcale étendue, le lu des Malinké, qui groupe généralement un patriarche, le fa (va dans le Konyâ) avec ses frères cadets et ses fils, leurs épouses et leurs enfants, ainsi que leurs captifs, quelques clients et des étrangers en voie d'assimilation.
Le lu se scinde généralement quand s'éteint la plus vieille génération et ce schéma pourrait s'appliquer à un système segmentaire classique 29. La famille étendue, limitée à trois ou quatre générations, correspond en effet à un lignage minimal et elle est emboîtée dans des lignages mineurs, majeurs et parfois maximaux.
Les lignages sont localisés, mais il est exceptionnel que chacun occupe un village entier, sauf dans les pays d'habitat semi-dispersé comme le Kisi et le Limba, dont les agglomérations sont minuscules 30.
Le lignage correspond généralement à un quartier (kabila ou bösö) et les gros villages qu'aiment les Manding en comptent souvent un nombre important.
Les lignages qui cohabitent ainsi, appartiennent généralement à des clans différents. En employant le mot « clan », nous restons fidèles à la terminologie de Delafosse, que la sociologie moderne n'a nullement désavouée 31.
Un clan manding compte une infinité de lignées locales, dont certaines peuvent être castées, mais qui ont en commun un dyamu, ou nom honorable 32, et une devise, le burudyu.
Plusieurs lignées reconnaissent le même tana, un interdit animal ou végétal pourvu d'une légende étiologique, mais qui vaut rarement pour tout le clan.
La sèñankuya, ou parenté à plaisanterie, l'alliance cathartique de Griaule, unit des clans par paires ou par groupes, mais cette pratique n'existe pas uniquement à ce niveau 33. On la retrouve en effet dans les relations entre ethnies entières comme les Dogon et les Bozo, et on pourrait la comparer aux relations particulières qui unissent dans chaque famille le grand-père et le petit-fils.
On doit garder à l'esprit que le clan n'est ni un groupe constitué ni un groupe résidentiel. Il est dispersé sur d'immenses espaces et figure souvent au sein de plusieurs groupes ethniques. Des lignées en relations fréquentes établissent des équivalences entre leur dyamu et le snobisme fait triompher la forme la plus prestigieuse. Des captifs émancipés adaptent généralement le nom de leur maître et des étrangers celui de leur hôte, afin de mieux s'enraciner dans leur nouveau pays.
Il n'est donc pas surprenant que les diverses lignées d'un clan ignorent leurs connexions généalogiques exactes. Le dyamu est pour eux le symbole d'une solidarité morale qui n'est d'ailleurs pas sans portée pratique puisqu'elle sert de cadre à la vie commerciale. Il est notoirement impossible de s'intégrer à un village manding sans adopter un dyamu avec tout le complexe socio-religieux qu'il implique.
Mais le clan n'a aucune personnalité politique ou religieuse. Sa dispersion exclut un chef, mais elle permettrait des autels ancestraux et un culte commun, alors qu'il n'en est rien. De telles institutions existent, mais elles sont le privilège exclusif des lignages, dans le cadre des villages ou des kafu.
C'est aussi le lignage et non le clan qui est exogame. Les mariages peuvent donc s'opérer de village à village et non seulement d'un quartier à l'autre. Chez l'ensemble des Manding il y a mariage préférentiel entre cousins croisés, mais limité à la fille de l'oncle maternel 34. Le lévirat est en outre une pratique universelle. Dans une société de ce type, il est naturel que la dot (furunãtolo) serve de preuve à l'alliance matrimoniale (birãnya) qui unit deux lignées car son remboursement est le principal obstacle à un divorce relativement facile. Sa dévolution détermine celle des enfants car ils reviennent à la mère s'il n'y a pas eu paiement. Sa composition et son importance varient à l'extrême. Les biens de prestige y tiennent toujours la première place, des boeufs, par exemple dans les pays où l'élevage est valorisé, et à peu près partout des tissus d'une qualité bien déterminée. Les prestations du fiancé au profit des beaux-parents sont généralement inversement proportionnelles à l'importance de la dot. Leur place est énorme chez les gens de la Forêt ainsi que chez les Sénufo qui ne procédaient, avant l'ère coloniale, qu'à des versements symboliques. Les Malinké insistent au contraire sur la dot et il est significatif qu'ils méprisent les enfants naturels, contrairement à la plupart de leurs voisins. Les mariages étaient rarement conclus avant la trentaine, sauf chez les musulmans, et la polygamie était très développée, mais seulement chez les hommes âgés.
Tout ceci est donc fort simple. Ces peuples ignorent les complications des systèmes matrilinéaires où les hommes commandent sans transmettre aucun droit. Chaque lignage localisé se distingue de ses homologues par un nom qui est formé par celui de l'ancêtre, auteur de la scission, augmenté du suffixe -si qui signifie « semence » 35. Il en va ainsi à chaque segmentation, depuis le lignage maximal jusqu'au lignage minimal lequel s'incarne habituellement dans un lu.
C'est ainsi que la mère de Samori appartenait aux Sémisasi de Fãndugu, une fraction des Fasèri-Kamasi qui dominent le kafu du Talikoro, et sont issus des Sé-Brèmasi.
Ceux-ci sont répandus dans les vallées du Milo et du Dyani, et se classent eux-mêmes parmi les Fen-Sémènési comme la plupart des chefs du Bas-Konyã.
Les Fen-séménési sont l'une des douze lignées Kamara du Konyã, qui se reconnaissent comme Féreñ-Kamasi, du nom de leur ancêtre conquérant, pour s'opposer aux Kamara du Haut-Niger et à une partie de ceux du Mau (Touba).
Il est remarquable que ces segmentations profondes soient le privilège des familles nobles dont elles justifient les prétentions sur les diverses chefferies du pays.
Les libres roturiers (horõ) 36 ne connaissent généralement que des lignages minimaux et mineurs. Quand ces derniers naissent par scission, en formant un nouveau lu, celui-ci est investi des seuls droits fonciers solides car il les reçoit directement ou indirectement du maître de la terre. Bien que le nouveau lu organise peu à peu le culte de ses propres ancêtres, il continue à participer à celui du lu issu de l'aîné. Chacun d'eux possède en tout cas, dès l'origine, une parfaite autonomie économique et politique. Tant qu'il ne se segmente pas, le remplacement du fa 37 est assuré selon la succession en Z 38, la fonction passant d'aîné à cadet, jusqu'à épuisement de la génération la plus âgée, avant d'échoir successivement, dans le même ordre, à ses fils classificatoires.
Le fa gère la « communauté taisible » décrite par Labouret, c'est-à-dire la totalité des droits fonciers et des immeubles, ainsi que de nombreux meubles (foroba) 39. Il dirige le travail de ses « enfants », qui disposent cependant de deux jours par semaine pour cultiver et acquérir des biens personnels. Il distribue entre les ménages 40 la nourriture quotidienne et arbitre les différends qui peuvent opposer les siens. Ses pouvoirs sont cependant disciplinaires et non judiciaires et sa patria potesta n'a rien de despotique 41. En fait, il ne décide rien sans l'accord de ses « frères » classificatoire, et il redoute les critiques des autres fa dont les filles sont mariées chez lui. Cependant, vis-à-vis de l'extérieur, c'est lui la seule personne majeure et responsable. Il incarne le droit de citoyenneté collectif du lu et lui seul est appelé à participer à la vie publique.
Il convient de souligner que ce tableau est valable seulement pour l'ensemble des Manding. Dès qu'on se tourne vers les ethnies marginales, tout se complique. C'est ainsi que chez les Forestiers, quelle que soit leur langue, la segmentation des lignages est inexistante ou imparfaite. Les généalogies sont courtes chez les Kisi. Chez les Toma ou les Dã, où elles sont plus longues, elles se raccordent rarement. On a donc affaire à une poussière de lignages de faible profondeur et il est très difficile de les classer car les segments issus d'une rupture ne gardent pas des relations institutionnalisées : il y a ici « fission ». Chez les Dã du Sud, la notion de clan parait même disparaître et la structure sociale n'est plus exclusivement patrilinéaire. Le travail du fiancé joue dans de tels cas un rôle croissant et le divorce devient difficile. La polygamie est alors très rare.
Si nous avions à traiter des Sénufo, la complexité deviendrait extrême. Ceux de l'Ouest ont des clans très nombreux, portant le nom de leurs yafunõ (tana), ceux de l'Est ne connaissent que cinq tyènè (dyamu) avec des équivalents malinké. Partout leurs lignées, patrilinéaires ou matrilinéaires, marquent une forte tendance à se replier sur elles-mêmes. De nombreuses formes de mariage sont nettement endogamiques. La dot, quand elle existe, cède le pas aux prestations du fiancé et elle n'est jamais remboursée 42. Le divorce est exceptionnel. La résidence est parfois uxorilocale, avuncolocale si l'on préfère , et c'est même la règle en Pays Nafagha.
En dehors des lignées souveraines qui forment l'aristocratie des tuntigi 43, les Manding se distinguent des autres ethnies par une division fondamentale de la société entre
La captivité est une pratique universelle en Afrique, mais les Manding ont toujours eu plus d'esclaves que les Forestiers ou les Sénufo. Sans qu'ils fussent spécialement mal traités, leurs captifs avaient plus de mal à accéder au statut d'hommes libres et à s'assimiler aux lignages de leurs maîtres 45.
Ils doivent être distingués des groupements professionnels comme les dyula commerçants mais aussi des corporations qui rassemblent des horõ, comme les chasseurs ou dõso 47. Ceux-ci forment des associations volontaires régis par un règlement (tõ) avec une forte hiérarchie, des cultes et des techniques, si bien que leur rôle militaire et politique est souvent considérable. Ils n'ont cependant rien d'héréditaire contrairement aux castes et celles-ci témoignent de l'ancienneté et du grand développement de l'artisanat dans les civilisations du Soudan occidental.
Les groupes castés du monde manding ne sont d'ailleurs pas tous présents dans notre domaine 48. Nous y trouvons
Les mabo, sègi, gawlo, tyadurta que l'on trouve du Sénégal au Moyen-Niger sont inconnus en amont de Bamako. Les bijoutiers, ou syagha sont souvent des numun spécialisés mais les autres artisans, comme les tisserands (dyésédala) ne sont pas castés.
La divination de son côté ne définit en tant que telle aucun groupe original 50.
Il faut enfin considérer à part les sous-ethnies spécialisées comme les pêcheurs Somono, qui sont seulement des horõ isolés par leur genre de vie.
Les nyamakala subissent une ségrégation sexuelle totale qui réduit chacun de leurs groupes à l'endogamie et l'opinion considère leurs moeurs comme suspectes. On en déduit qu'ils sont méprisés, ce qui est vrai seulement des garãngè et surtout des kulé. En fait, ils sont tenus à l'écart en raison des forces redoutables qu'ils affrontent dans leurs activités techniques. Le cas des numun est particulièrement net car leur maîtrise du feu et du métal en fait des personnages redoutés et craints. Ils ont le contrôle du Komo, la société d'initiation qui ouvre à tous la connaissance et dont les dyèli sont justement exclus 51.

En raison de leur importance extrême dans la société malinké, les griots, c'est-à-dire les musiciens méritent une attention particulière 52.
Les finè, griots des clans Bula, exercent souvent le métier de vannier et sont particulièrement estimés comme traditionnistes. Les dyèli sont cependant les véritables griots, artisans de la parole, et Zahan insiste sur le fait qu'ils animent le passé, de façon à exalter la force vitale (nyama) de leur partenaire. De là leur réputation de menteurs alors que les véritables traditions, legs efficaces des ancêtres, sont détenus par les fa des lignées horõ. De là aussi leur exclusion des sociétés d'initiation didactiques (Komo, Kono, Nama) et le mépris qu'affectent à leur égard les hommes libres dont l'idéal est la réserve et le silence. Zahan explique que le cadeau qu'exige chaque griot comme une compensation nécessaire à l'enflure qu'il a procurée.
Ceci nous invite à étudier la fonction sociale des griots. En dehors de l'exaltation des valeurs de courage et de générosité, le griot détient une puissante force de nivelage. Il contraint les riches à mettre leurs biens en circulation et empêche ainsi l'accumulation de fortune individuelles excessives qui menaceraient l'égalitarisme traditionnel. Ses connaissances du passé, bien que limitées à certains registres, lui permettent de peser sur la vie politique. Il est un véritable catalyseur social qui met en compétition les groupes en présence (classes d'âge, lignées), révèle leurs statuts réciproques et arbitre entre eux. C'est donc un élément de cohésion et l'importance que lui accordent les Malinké confirme que nous avons affaire à une société dont la forte structure lignagère est hostile aux ambitions individuelles, mais favorise l'affrontement des groupes qui la constituent.
Les Sénufo, comme la plupart des paléonégritiques, possèdent des castes allogènes qui sont généralement d'origine manding, mais ne paraissent pas très anciennes. Ces institutions sont parfaitement étrangères aux peuples de la Forêt qui ignorent aussi bien les dyèli que les numun. Leurs griots et leurs « forgerons » sont des hommes libres comme les autres, libres de toute ségrégation sexuelle et qui suivent une tradition familiale ou une vocation individuelle. Il est vrai qu'ils extraient rarement le fer des entrailles de la terre, ce qui ne donne pas la même tonalité magique à leurs activités.
En Afrique occidentale, le système des castes est donc caractéristique des cultures des savanes que Baumann qualifiait de néosoudanaises. Ce n'est évidemment pas un hasard et on est en droit de se demander s'il n'a pas pris forme à l'époque des Empires médiévaux qui auraient à la fois donné un cadre plus vaste aux compétitions des groupes, et permis une diversification considérable des techniques.
Plusieurs lu voisins, apparentés, ou du moins de condition analogue, forment un quartier (su-kala, kabila, bösö), qui est un groupement de fait, dépourvu d'institutions propres, à moins qu'il ne se confonde avec une famille très étendue 53.

La première unité constituée qui transcende le lu est le village dont le nom malinké, dugu, définit un territoire et non un ensemble de constructions (so). Sa structure est assez démocratique bien que la place de chef (dugutigi) soit réservée en principe au fa du lignage aîné 54. Celui-ci est en effet seul lié aux divinités du terroir (dasiri) dont le culte s'exerce exclusivement dans le cadre du village, comme celui des ancêtres dans celui du lignage 55. Les droits fonciers des autres lu dérivent donc exclusivement des siens.
Le dugu est donc avant tout une unité religieuse et une association rituelle responsable des grandes fêtes annuelles. Il célèbre ainsi le nouvel an animiste ou Dyõmbènè, qui tombe régulièrement après le solstice d'hiver, en chaque mois de janvier, tandis que celui des musulmans se déplace au rythme de l'année lunaire. Le Dõmba annonce trois mois plus tard l'approche des travaux agricoles dont la fête des semailles marque le début tandis qu'à celle des récoltes (Dugu-sõ) les prémisses assurent la bienveillance des puissances invisibles (septembre-octobre).
Le dugutigi n'est que le plus respectable des fa, un « primus inter pares », et non un despote séculier 56. Cet égalitarisme foncier est matérialisé par le gbá, un hangar sous lequel il siège avec ses collègues en bordure de la place publique (fèrè) où le peuple assemblé murmure Cette espèce de Conseil, sans lequel le chef ne peut rien faire, exclut les fa des lignées nyamakala et captives, à l'exception cependant des numun et des finè. Il réunit donc les tuntigi et l'ensemble des horõ.
Cette assemblée judiciaire et politique fait comparaître les accusés en présence de la foule, qui ne peut opiner, mais manifeste parfois. Elle tranche les différends qui opposent des lu et elle incarne le village, qui est collectivement responsable vis-à-vis de l'extérieur. Elle contrôle le travail des associations de jeunes gens (tõ) et ses membres sont souvent les dignitaires des sociétés d'initiations (dyo). Celles-ci sont organisées dans le cadre du village et forment un élément essentiel de sa personnalité.
En raison de leur rôle politique, et parce qu'elles ont généralement incarné l'animisme à l'encontre de l'Islam, ces institutions méritent de nous retenir un instant. Elles servent à parer au danger d'éclatement qui pèse inéluctablement sur une démocratie patriarcale de ce type. Des lignées parfaitement localisées et autonomes présentent en effet une cohésion morale extrême et risquent de se heurter en des conflits sans issue. Pour maintenir l'unité du village et même, nous le verrons, du kafu, il est nécessaire de passer une trame en travers de cette chaîne.
Sur le plan économique et éventuellement militaire, tel est le rôle des kari dont le nom se traduit approximativement par classe d'âge. Chacune groupe les garçons circoncis ensemble lors du grand rituel qui a lieu tous les sept ans. Le kari crée un lien moral très fort entre ses membres et chacun d'entre eux porte un nom qui s'insère dans un cycle régulier de sept unités. La vie sociale suit donc un rythme de quarante neuf ans entièrement indépendant des structures lignagères.
Le système des kari s'articule sur la vieille notion malinké des tõ, c'est-à-dire des associations régies par un règlement. Les deux réalités ne se recouvrent pas nécessairement et c'est ainsi que Meillassoux a souligné récemment que le tõ qui a joué un rôle fondamental dans la construction de l'Empire de Ségou était une organisation de chasseurs (dõzo) étrangère au système des classes d'âge 57.
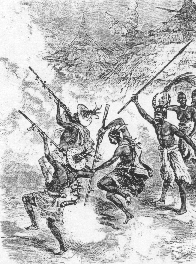
Partout où les villages sont assez gros pour que le kari ait un effectif suffisant, ceux-ci s'organisent ou se groupent par deux pour former des tõ dont la première tâche est d'organiser les jeunes gens d'un village, quelle que soit leur lignée, pour les travaux collectifs et l'entraide, mais aussi pour le loisir. (Chaque tõ est pourvu d'une hiérarchie et d'un trésor, et les filles ont une organisation parallèle. Le tõ joue un rôle important dans la police du village mais le fait essentiel est qu'il cristallise l'esprit de solidarité forgé par les kari. Il équilibre ainsi efficacement le séparatisme des lignages, mais il menace dans une certaine mesure l'autorité des anciens. Dans tout le monde manding, il jouit en effet d'une véritable autonomie qui le distingue nettement des organisations analogues des Sénufo ou des Bobo qui sont étroitement contrôlées par la gérontocratie du village.
Par la discipline, voire l'entraînement qu'il imposait, le tõ était également une initiation à la vie guerrière. Celle-ci s'organisait cependant dans le cadre des kari d'adultes, libérés par la formation d'un nouveau tõ. Nous verrons que la succession des générations que les classes d'âge incarnent correspondaient à une spécialisation des rôles militaires, les actions les plus vigoureuses étant réservées aux plus jeunes.
Si la structure des tõ limite dans une certaine mesure l'autorité des anciens, des organisations religieuses qui leur sont étroitement soumises viennent aussitôt la rétablir. Ce sont les dyo, ou sociétés d'initiations qui dominent toute la vie sociale et culturelle du village manding traditionnel. Les masques et objets rituels qu'ils requièrent, ont inspiré les plus belles oeuvres de la sculpture soudanaise 59. Leurs cérémonies publiques ont été décrites depuis longtemps avec plus ou moins de bonheur, mais nous commençons seulement à en connaître le sens ésotérique, l'esprit et le mécanisme, grâce aux travaux de D. Zahan.
En dehors des grandes cérémonies d'initiation, qui suivent généralement un cycle septennal, les dyo se manifestent aux funérailles de leurs membres et aux grandes fêtes qui rythment l'année. C'est le cas des semailles ou de la récolte comme de la chasse collective qui marque l'incendie de la brousse en début de saison sèche. Leur rôle essentiel est la formation morale et spirituelle des jeunes, que cette éducation collective doit transformer en citoyens utiles et bien équilibrés, adaptés à leur place dans la société. Leurs hiérarchies discrètes, mais nullement secrètes, où les chefs politiques ne sont pas nécessairement au premier rang, assurent une régulation efficace de la vie du village. Certains de leurs agents masqués interviennent en cas de trouble ou pour mettre à la raison les éléments antisociaux. On comprend que les oppresseurs allogènes, comme les Toucouleurs au pays de Ségou, s'en soient inquiétés et aient tenté de les dissoudre. La méfiance et l'hostilité des Français seront souvent aussi grandes, mais en vain. Il faudra la révolution sociale née de la colonisation pour mettre leur existence en danger
S'il n'est pas question d'étudier ici le fonctionnement des dyo, il convient de donner une idée de leur répartition géographique car celle-ci n'est pas uniforme, mais indique des équilibres sociaux bien différents et révèle d'anciens courants de migration ou du moins de diffusion.
Dans leur terroir principal qui s'étend du Bélédugu au Baninko, à travers les vallées du Niger et du Bani, les dyo classiques sont au nombre de six:
Les six dyo ne sont à vrai dire réunis que dans un petit nombre de villages et leur fréquence est très inégale. Le Nyomo, qui ouvre la porte aux autres est presque partout présent, les quatre sociétés intermédiaires sont fréquentes, mais le Korè n'existe que dans quelques centres privilégiés auxquels il assure une véritable hégémonie rituelle 61. Le Komo reste le plus fréquent en raison du rôle essentiel qu'il joue dans la chasse aux sorciers (suubagha).
Ces dyo classiques forment un système complexe mais cohérent dont l'extension à un vaste territoire homogène suppose une diffusion assez récente qui leur aurait permis de supplanter des institutions analogues 62. Rien n'atteste en effet l'ancienneté des sociétés d'initiation dans leur forme actuelle, mais leur principe est sans doute très ancien, peut-être antérieur à l'introduction de l'agriculture.
Quoi qu'il en soit, le complexe des six dyo ne recouvre pas exactement les pays malinké et bambara. Il en déborde au nord de Sikasso pour mordre largement chez les Sénufo. Partout ailleurs, il n'en atteint pas les frontières car il se heurte à la concurrence de sociétés analogues qui l'excluent par définition puisqu'elles remplissent les mêmes fonctions. De Ségou à Djenné, tel est le cas du Nya, qui s'étend largement hors du domaine Mandé puisqu'il intéresse l'ensemble des Sénufo du Nord (Minyãnka et Kénédugu) 63.
La principale lacune est cependant au sud. De ce côté, les dyo du XIXme siècle s'arrêtaient aux approches de Kouroussa et de Kankan. Dans l'Empire de Samori, ils dominaient seulement dans les marches du nord, de Siguiri à Kangaba et, plus à l'est, de Bamako au Baninko. On ne les rencontrait pas dans l'immense domaine des Malinké méridionaux, de la Sierra Leone jusqu'au Bandama, ni même chez les Bambara de Bougouni, mais cela ne veut pas dire que ces gens ignoraient toute initiation. A défaut des six dyo, ils en chargeaient une société unique, qui pouvait provenir du développement excessif de l'un d'eux, comme le Komo, ou bien unir en elle toutes leurs fonctions, comme c'est le cas du Djo.64
Le Djo, qui est propre aux Bambara, domine la moitié orientale du cercle de Bougouni, Baninko exclus, mais Bana inclus. Sa limite occidentale suit à peu près le cours du Baulé qui le sépare du Wasulu où règne le Komo. Vers le sud, on le trouve, jusqu'aux portes d'Odienné (Côte d'Ivoire) et il a pénétré largement chez certains Sénufo. C'est le cas dans l'Ouest du Noolu à Boundyali où il prend le nom de lo et surtout vers Sikasso où on qualifie ses membres de bu (plur. bubu). Le Djo est fort complexe: il est divisé lui-même en quatre catégories entre lesquelles se répartissent les initiés ou kiba 65 dont le nom est fréquemment employé dans le Sud pour désigner la société elle-même. Celle-ci est d'ailleurs pauvre en masques sculptés. Vers Odienné, la catégorie la plus fréquente est le Ndoko dont les kiba portent d'ailleurs un costume influencé par les porõ Sénufo 66. Ils tiennent bien le rôle de « bouffons sacrés » que V. Paques a décrit pour Bougouni, mais ils sont accompagnés d'un masque sculpté, le gbõ (cynocéphale) qui paraît d'origine Sénufo. Tel est en tout cas certainement le cas du navèvè, qui fait la police du village, masqué d'une cagoule brune et, jadis, percevait les péages.
Zahan voit dans le Djo la « confrérie souche qui a donné naissance par bourgeonnement à tous les autres dyo Bambara » 67. S'il s'agit vraiment de la survivance d'un ancien état de choses, il est probable que l'institution occupait jadis un plus vaste territoire. On trouve en effet vers Sinko, dans le Haut-Konyã, des tombeaux creusés sous roche, analogues à ceux que V. Paques signale, vers Bougouni, comme réservés aux Sya, chefs du Djo. La tradition les attribue aux Guerzé, anciens habitants du pays, mais elle confirme l'existence ancienne du Djo qui paraît avoir existé ici avec le Komo, avant d'être supplanté par lui. Il paraît avoir disparu du temps de Samori, sauf au sein de la minorité Fula qui l'a pratiqué du côté de Sinko jusqu'en plein XXme siècle.
Les centres principaux du Djo se trouvent autour de Bougouni, c'est-à-dire dans une marche excentrique, qui n'a obéi à l'Almami que pendant une dizaine d'années mais a subi de fortes persécutions durant la crise théocratique de 1886-88 68. Il est donc remarquable que la société se soit reconstituée dans cette région où elle montre encore une certaine vitalité, alors que vers Odienné, où la tolérance des Turé du Kabasarana l'avait préservée de toute avanie, elle a connu un décadence précoce dès l'aube de l'ère coloniale.
A l'ouest du Baulé, dans le Wasulu puis, autour de Kankan, dans le Sãnkarã, le Torõ et le Kuranko, la situation est très différente. On n'y trouve pas une confrérie synthétique comme le Djo, mais la plupart des dyo du nord disparaissent pour laisser la place libre au seul Komo qui envahit toutes les fonctions 69. En poussant vers le sud et l'est, on constate que le Komo supplante d'abord le Djo au Konyã et au Mau avant de se raréfier à son tour et de céder la place à des sociétés d'un type très différent. Celles-ci paraissent avoir subi l'influence des Sénufo voisins, quand elles ne leur ont pas été purement et simplement empruntées.
On ne saurait douter que ce Komo d'un nouveau genre soit un rejeton de son homonyme du nord 70. Les forgerons y jouent le même rôle après avoir supervisé la circoncision. La sculpture du masque s inspire de styles divers, mais son dispositif d'ensemble ne varie pas : sa face est toujours fixée au bout d'une longue perche qui permet d'en régler la hauteur, de façon à symboliser, selon Zahan, l'extension de la connaissance 71. Les sculpteurs du Kuranko restent d'ailleurs fidèles à la tradition soudanaise tandis que ceux du Konyã et du Mau (Touba, Côte d'Ivoire) se montrent sensibles aux influences forestières 72.
Le Komo est toujours un grand chasseur de sorciers, mais il semble qu'il ne suffise plus à ce rôle puisqu'il admet à ses côtés des concurrents dont nous parlerons bientôt. En pays kuranko, il tend d'ailleurs à s'effacer derrière le rite de la circoncision, dont il contrôle partout l'exécution, mais qui devient ici essentiel 73. Comparable à l'excision des filles, cette mutilation n'est généralement qu'un prélude à diverses initiations auxquelles elle n'est pas toujours intimement associée. Elle paraît très antérieure à l'impact de l'Islam, qui l'a cependant renforcée, mais elle n'est pas universelle en Afrique Occidentale. Les paléonégritiques ont généralement cette pratique en horreur, alors qu'ils pratiquent tous l'excision. Parmi les Sénufo, la circoncision n'est acceptée que par les groupements occidentaux de Boundiali à Sikasso, sans doute sous l'influence des Manding. La plupart des peuples de la Forêt, et particulièrement les Kru rejettent entièrement les mutilations sexuelles qu'ils remplacent par des scarifications. Tel est le cas des Kisi, à l'exception des cantons du nord (Farmaya) qui pratiquent des coutumes de type Kuranko. Les Mãndé de la Forêt se partagent cependant de part et d'autre du Sassandra. Ceux de l'Est (Guro) ne pratiquent ni la circoncision ni l'excision, alors que toutes deux sont universelles chez les ethnies de l'Ouest (Guerzé, Toma, Mendé). Dans cette partie du continent, on a le sentiment que la diffusion de ces pratiques est surtout un fait mande, alors que la tradition des scarifications faciales à signification ethnique ou clanique est universelle dans les savanes. Elle est particulièrement développée chez les Paléonégritiques et déborde même le domaine du limage des dents qui s'est étendu à certains Manding (Konyã, Bambara) 74.
L'étude du Komo méridional n'a jamais été menée à bien et ses manifestations publiques elles-mêmes n'ont guère été décrites, sinon chez les Kisi. Ce travail pose actuellement des problèmes fort difficiles mais il est d'une urgence extrême car la frange méridionale du monde malinké a été le théâtre d'un islamisation particulièrement intense durant l'ère coloniale. Ce Komo a en effet presque entièrement disparu ces dernières années, à l'exception de quelques villages voisins de Touba (Côte d'Ivoire) et du Kurãnko occidental, en Sierra Leone.
Il faudrait combler cette lacune, s'il n'est pas déjà trop tard, car ce Komo, très différent de celui du nord, présente pour nous un intérêt considérable 75. Il faut y voir la pièce maîtresse de l'animisme du Konyã et Laafiya Turè y était initié. Samori le connut lors de sa circoncision et sa vocation précoce de dyula l'empêcha seule d'en devenir membre. La connaissance de cette institution nous fournirait de précieux éléments de comparaison en raison de sa position marginale et des syncrétismes qui en découlent. Elle a en effet franchi la frontière du monde Manding pour s'imposer, sous une forme assez dégradée, aux Kisi du nord 76 et aux Konor de Nzèrèkoré 77. Elle a donc pu s'adapter à des sociétés très différentes de celles de la savane, dépourvues notamment des forgerons castés qui la régissent habituellement. Elle n'en est pas moins reconnaissable et le masque étrange que nous montre A. Schaeffner répond au même dispositif général que ceux des pays du nord.
Le Komo pouvait difficilement assumer seul les fonctions des six dyo et on est en droit de penser que les Malinké du sud ont éprouvé assez vite le sentiment d'un vide rituel. L'absence la plus sensible était celle du Tyiwara, stimulateur de la fécondité agricole. C'est pour y parer que deux sociétés se sont formées spontanément au Sãnkarã, sans doute vers la fin du XVIIIme siècle. La plus célèbre est celle des Kursikoroni (« vieux petits pantalons ») qui s'est répandue sur la vallée du Niger de Kouroussa à Siguiri et dans l'ensemble du Wasulu et du Konyã jusqu'à Odienné. Ses membres, les Dãngwasogho se reconnaissent à la longue mèche nattée qu'ils portent au sommet du crâne avec une petite corne amulette (sogho) fixée à son extrémité. Ils sont surtout connus par des manipulations du feu que les Ballets Africains de la République de Guinée ont popularisées au moment précis où son gouvernement interdisait la confrérie dans son terroir d'origine. Les Kursikoroni, dispersés en assez petit nombre à travers plusieurs kafu, se réunissent pour cultiver, revêtus de haillons, d'où le nom de leur société. Leur efficacité n'est pas niable et ils paraissent ignorer la fatigue, qui est censée retomber sur les spectateurs. On louait leurs services à un tarif déterminé, mais dans un esprit exclusivement économique car la cérémonie du feu servait seulement à démontrer leurs pouvoirs surnaturels. Leurs chefs portent le titre musulman de Karamogho et il est remarquable que leur succession soit étrangère à toute considération lignagère. Le dignitaire désigne de son vivant le membre qu'il juge le plus digne, quelle que soit son origine 78.
La société des Bãndofarima, qui paraît plus récente, ressemble comme une soeur à la précédente, mais son culte remplace les cérémonies du feu par des danses particulières. Elle se juxtapose aux Kursikoroni de Siguiri à Kouroussa, mais elle s'étend bien plus loin vers l'ouest à travers le Sankarã de Farana et une partie du Kuranko.
Une dernière fonction, essentielle dans le monde Manding, comme dans la plupart des sociétés ouest-africaines, était la chasse aux sorciers Ces derniers, les suubagha 79 sont des personnages sinistres qui se transforment de nuit en animaux pour dévorer les âmes des gens, et il est certain que la société malinké permet à ses membres de défouler leur agressivité sur ces criminels. Le Komo, leur principal ennemi, paraît dans cette région ne pas avoir suffit à la tâche. Leur recherche incomba donc à une nouvelle société, celle des Gwasatigi, qui est originaire cette fois du Torõ mais qui a étendu son activité de Siguiri à Beyla. Quand ses robustes jeunes gens envahissaient un village, munis du gwasa 80 qui allait dénoncer les sorciers, la terreur régnait car n'importe qui pouvait être accusé et exécuté sommairement. La fin de l'ère coloniale a vu les « jeunesses » de certains partis politiques mener des campagnes d'épuration dans une ambiance analogue.
Aucune des sociétés n'employait de masques, sculptés ou non. Les Malinké du Sud en possèdent pourtant un certain nombre, généralement empruntés aux peuples de la Forêt, dont on a signalé l'influence sur le style de certains Komo. Le plus répandu est le sagbwèma, reconnaissable à son énorme bec qui est d'origine Dã 81. Ce masque comique est chargé de la police du feu en saison sèche, et il se rencontre assez au nord, jusqu'à Beyla, Odienné et Séguéla. Il est remarquable qu'il soit présent partout, même dans les plus anciens villages musulmans, car ceux-ci font valoir qu'il n'a aucun caractère religieux.
On peut en dire autant des fameux masques à échasses (Nya-Dyã: esprit long) que leurs acrobaties extraordinaires ont popularisées 82. On les trouve en Forêt, du Kisi au Sassandra, avec deux pôle chez les Toma et les Dã. Cette institution sécularisée a franchi toutes les barrières religieuses et ethniques. On la rencontre en savane chez les Kurãnko de l'Est, et les Konyãnké, ainsi que dans le Mau et le Worodugu de Séguéla. On la signale même dans le Ghana, sur la frontière des Sénufo 83.
Si les Malinké de la frange forestière ont ainsi emprunté à leurs voisins, ils n'ont pas radicalement transformé leur société, comme ont dû le faire d'autres avant-gardes manding. Tel est le cas des Kono de Sierra Leone, qui gardent bien des points communs avec leurs ennemis Kurãnko, mais dont le système d'initiation appartient à une autre famille 84. Il est fondé sur la société masculine du Porõ 85 et les sociétés féminines du Bundu ou du Sanda, c'est-à-dire sur un ensemble qui caractérise la plupart des peuples de la Forêt, du pays des Rivières au Sassandra, particulièrement les Mandé du Sud (Mèndé, Toma, Guerzé, une fraction des Konor, Mano) et une bonne partie des Kisi 86.
Les derniers Komo que nous avons repérés, se trouvent isolés dans le Worodugu, au-delà du Sassandra, car celui-ci marque un clivage culturel important. Dans cette marche ultime du pays malinké règne en effet une forme d'initiation très originale, qui porte le nom de lo, et dont le rituel est analogue à celui du porõ Sénufo 87. Telle est la coutume que suivent tous les Dyula de Kong, anciens, quand elle ne les a pas détournés à son profit, comme ceux du Kutubi 88.
L'extrême diversité des institutions que nous venons de passer en revue n'a rien de surprenant, compte tenu de la grande étendue des terres malinké et bambara. On s'attendrait, en vérité a un morcellement beaucoup plus grand encore et celui-ci s'amorce en effet dans les marches où les métissages et mutations culturelles sont de règle.
L'unité fondamentale n'en reste pas moins évidente. Nous sommes même en droit de penser qu'il s'agit d'une unité qui transcende le monde mãndé, si nous considérons les sociétés d'initiation des forestiers et des voltaïques. Au-delà de l'infinie diversité du rituel, le Porõ des Forestiers, et le porõ des Sénufo répondent en effet au même schéma. Cette rencontre n'est évidemment pas due au hasard et on doit supposer que tous les porõ ont une origine commune qui remonte probablement à l'époque où les ancêtres des Guèrzè, vers Beyla et Sinko, voisinaient avec ceux des Sénufo qui tenaient la région d'Odienné (avant le XVIme siècle). Il s'agit donc d'une institution venue du nord et on peut admettre qu'elle a, elle aussi, des racines mãndé. L'adaptation du rituel au milieu sylvestre ne doit pas s'y opposer puisque les plus vieux peuples de la Forêt ouest-africaine, qui sont incontestablement les Kru, ne possèdent rien de semblable. Ils connaissent par contre des sociétés criminelles comme celle des hommes-panthères, toujours liées à l'anthropophagie, et parfaitement étrangères au monde manding 89. L'importance sociale des initiations ne saurait être surestimée, mais son incidence directe sur la vie politique varie, selon l'équilibre spécifique à chaque ethnie. Dans les pays coutumièrement morcelés comme ceux de la Forêt, ou même chez les Sénufo les plus traditionalistes, les sociétés peuvent devenir un véritable gouvernement occulte. Little a montré récemment comment en pays Mèndé le porõ pouvait être un facteur de cohésion et agir sur de vastes étendues. Les tendances anarchiques dont on taxait ce peuple sont donc plus apparentes que réelles 90.
Chez les Manding, le rôle politique des dyo est beaucoup moins net parce que la vie politique est fortement institutionnalisée à un niveau supérieur à celui des villages. Ceux-ci sont en effet intégrés à des kafu où il faut voir de véritables Etats, malgré leurs dimensions souvent restreintes. Les dyo sont hiérarchisés dans le même cadre, si bien qu'au lieu de contrôler le pouvoir, ils sont, dans une certaine mesure, dominés par lui et servent à le fortifier 91.
Kafu qui signifie « assemblée », désigne l'unité politique traditionnelle des Manding et le mot canton (de la colonisation française) en traduit mal la nature. Cette institution s'oppose fortement aux nébuleuses de lignées qui régissent la vie publique des sociétés segmentaires, comme les paléonégritiques du bassin de la Volta (Lobi, Tallensi), ou encore aux « tribus » de la Forêt qui unissent tant bien que mal des lignages hétéroclites rassemblés dans une zone déterminée. (Bété et généralement Kru).
Le kafu se définit en effet par un territoire bien délimité sur lequel un lignage maximal dispose de prérogatives politiques. C'est le sommet d'une pyramide qui coiffe un nombre déterminé de villages, composés eux-mêmes de familles étendues 92.
Labouret nous a conté la formation d'un kafu bambara 93. Bien qu'il s'agisse d'un cas particulièrement simple, ce schéma est valable pour l'ensemble du monde manding. L'ancêtre du lignage fondateur a trouvé un pays désert ou en a chassé les anciens habitants, et a en tout cas noué des liens avec les divinités autochtones. Ce lignage a souvent perdu le pouvoir politique, mais son chef garde certaines prérogatives comme Maître de la Terre (Shudugutigi, Dugukolotigi). Il reçoit des prémices symboliques aux récoltes et exerce un droit éminent sur certaines espèces, particulièrement les nèrè. Le territoire du Maître de la Terre ne coïncide pas nécessairement avec celui du kafu, qui peut être beaucoup plus vaste. Cette discordance est générale chez les Bambara et à l'est du Sassandra. Chez les Malinké au contraire, la lignée fondatrice est souvent restée souveraine et les deux fonctions se confondent en un seul personnage.
A partir de cette genèse, souvent à demi-mythique, la croissance d'un kafu suit des lignes assez simples. Le noyau initial accueille des lignées allogènes et le village initial, ainsi grossi, essaime aux alentours, tandis que de nouveaux immigrants sont autorisés à établir d'autres agglomérations. Le résultat est un mélange de clans et même de races, car les Fula, toujours présents, gardent la conscience de leur origine. Le kafu n'en acquiert pas moins une forte personnalité, qui est fondée sur une espèce de sentiment national, sans lequel il éclaterait.
Contrairement à celle du village, cette personnalité ne repose pas essentiellement sur des structures religieuses. Celles-ci sont évidentes, mais leur rôle est accessoire et Labouret a peut-être trop insisté sur ce point. Les cultes collectifs ne jouent ici qu'un rôle médiocre alors qu'ils sont fondamentaux au niveau du dugu. Les rituels assurés par le Maître de la Terre sont bénéfiques pour tous, mais ce dignitaire officie seulement en qualité de chef de lignage. Les chefs et notables des villages se réunissent chaque année au moment des récoltes (minkaro, octobre-novembre) pour régler leurs différends en présence du Mãsa mais cette assemblée (ladili) était toujours postérieure à la fête des prémices, célébrée exclusivement dans le cadre de chaque village. La grande fête septennale qui rassemble toutes les lignées entre la récolte et la circoncision est la seule occasion , où les sacrifices jouent un certain rôle au niveau du kafu.
Celui-ci se définit donc essentiellement comme une unité économique, judiciaire et militaire, c'est-à-dire politique. Ses villages utilisent en commun les zones désertes pour la cueillette, la récolte du bois, le pâturage et la chasse. Chaque kafu possède au moins un marché périodique et souvent même plusieurs, qui alternent selon un cycle, quand son territoire est vaste. Le contrôle du marché principal incombait au Mãsa dont les agents assuraient l'ordre et percevait les taxes. C'est donc lui qui réglait les relations commerciales, toujours actives dans le monde manding. La semaine qui est ici de sept jours, permettait de coordonner les marchés de plusieurs kafu, dont les populations restaient ainsi en contact 94.
Ce contrôle des terres et du commerce entraîne naturellement une fonction judiciaire. Le kafu était une aire de droit où les conflits, quand ils opposaient des villages différents ou s'avéraient insolubles dans le cadre de l'un d'eux, étaient tranchés selon une procédure, en excluant tout recours à la force. Ceci impliquait des pouvoirs de police et une organisation militaire. Autour d'un noyau d'hommes armés, le kafu mobilisait en effet ses citoyens dans le cadre des classes d'âge. Il répond donc parfaitement à la définition d'un Etat souverain 95.
Cette prédominance du facteur territorial sur la structure lignagère est universelle dans le monde manding, ce qui ne veut pas dire que les kafu sont tous du même modèle. La complexité de leur organisation varie généralement en fonction de leur taille et on peut, dans une certaine mesure, les classer selon les règles déterminant la dévolution du commandement.
Dans les petits kafu du pays bambara, et nulle part ailleurs, on voit souvent le commandement réservé à une branche aînée du lignage fondateur, donc à un lignage minimal. Nous avons alors affaire à une « succession en Z » classique, le même homme étant lutigi, dugutigi et souvent Maître de la Terre 96. Ce n'est donc qu'un patriarche comme les autres, mais le lu qu'il dirige est spécialisé dans le commandement. Cette règle se retrouve souvent dans les Etats de conquête, comme Ségu et le Kaarta quand la prédominance absolue des proches parents du fondateur n'est pas encore contestée. Il arrive même que la succession s'établisse entre un père et son fils « né dans la chefferie » tant que l'anarchie militaire ne vient pas tout remettre en cause.
Cette restriction du commandement à un groupe étroit atteint le plus haut degré quand la norme islamique a pesé sur les coutumes. C'est le cas, notamment, à Kankan où l'on tend à une succession de père en fils, sous réserve que l'intéressé s'en montre digne. Samori voudra à son tour suivre cet exemple, mais il faut souligner qu'il s'agit d'une solution aberrante limitée aux minorités musulmanes (Nyumamãndu, Haut Konyã).
Dans la plus grande partie des kafu traditionnels, la succession politique se démarque nettement de celle des familles. La chose est d'ailleurs inévitable du fait de la segmentation du lignage souverain en plusieurs lignages majeurs, largement dispersés dans l'espace. Les éléments qui en résultent sont généralement au nombre de trois, mais ils s'implantent selon des modalités très variées 97.
Dans le cas le plus simple, chaque segment s'installe dans un quartier et le village initial maintient son unité tandis que les villages secondaires se forment par essaimage à partir de l'un ou l'autre quartier. Le commandement du kafu alterne alors entre les trois lignages mais il demeure le monopole du village fondateur qui garde les tombes des premiers ancêtres. Il en résulte que les valeurs religieuses restent prééminentes, mais l'autorité politique est d'autant plus faible. Si le chef du kafu jouit d'un prestige incontesté, c'est un arbitre plus qu'un souverain et il doit agir avec diplomatie dans les villages périphériques.
Tel est l'équilibre que nous trouvons dans des ethnies à structurepolitique lâche comme les Bambara du Sud, et particulièrement ceux du Baninko.
Les Malinké du Sud, à l'ouest du Sassandra, y compris les Konyãnké et les Kuranko, illustrent une tendance différente. Chez eux chaque lignage majeur fonde un village, et le choix du Mãsa alterne souvent entre trois agglomérations.
Nous rencontrons enfin une autre solution sur les riches terres du Niger, de Siguiri à Kouroussa. Ici les trois lignages majeurs sont présents dans chacun des principaux villages et le commandement alterne régulièrement entre eux. Il passe alors sans ordre défini d'un village à l'autre 98.
La succession politique s'écarte donc ici de la succession lignagère tandis qu'elle se confond avec elle chez les peuples à faible structure politique comme les « anarchies » voltaïques, mais aussi chez les Kisi et même les Sénufo. Il est vrai que ceux-ci n'ont aucun commandement traditionnel au-dessus du niveau du village 99, alors que chez les Manding nous sommes en droit de parler d'Etat au niveau du kafu.
Le kafu s'incarne donc dans un personnage qui commande souvent un village, mais qui n'est pas simplement le premier des égaux 100. Le nom de kafu-tigi ou dyamaana-tigi, qui a fait carrière durant l'ère coloniale peut cependant faire illusion, par comparaison avec dugu-tigi ou lu-tigi. Cette expression décrit une position, mais ce n'est pas un titre. Elle s'est généralisée en raison des bouleversements imposés par l'autorité européenne qui a ruiné les kafu en créant des cantons artificiels et en violant les règles de succession. Des chefs imposés par le colonisateur coexistaient souvent avec des personnages occultes reconnus par le consensus popularis. Les premiers étaient, dés lors, « maîtres du canton », mais on ne leur accordait pas le titre traditionnel de légitimité qui est Mãsa chez l'ensemble des Malinke du Sud, du Niger au Bandama.
Ce vieux titre est évidemment issu du Mali médiéval où il paraît avoir été longtemps réservé à l'Empereur 101, tandis que ses gouverneurs portaient le titre de farba 102. Durant la décadence de l'Empire, il est en tout cas certain que des grands vassaux, sans doute alliés à la lignée souveraine l'avaient usurpé dans certaines régions périphériques, sans rompre pour autant avec leur seigneur. Tel était le cas en Casamance à la fin du XVme siècle 103. Comme il ne s'agissait pas là de gouverneurs révocables et souvent d'origine servile, mais des chefs de familles puissantes, on comprend que ce titre se soit imposé partout, par imitation, durant la dislocation du Mali. Il est employé de nos jours par les moindres chefs politiques dès qu'ils prétendent à la souveraineté et même, à côté d'eux, par de nombreux dignitaires religieux, souvent héritiers de lignées déchues.
Il a en outre été adapté par les Kisi et les Mãndé de la Forêt. Les Kono l'emploient au niveau des chefferies et les Toma à celui des gros villages 104.
Mãsa dériverait en effet de Maa ou Magã que Delafosse traduit par « maître, seigneur, ancêtre » 105. Ce mot s'oppose dans l'esprit des Malinké à Faama qui connote une idée de force pure et simple et s'applique facilement à une domination fondée sur la contrainte 106. La plupart des fondateurs d'Etats militaires ont adopté ce dernier titre et il est significatif que Samori le portera durant une bonne partie de sa carrière et ne revendiquera jamais le premier.
Dans le cadre du kafu, si petit soit-il, le Mãsa est en effet un souverain traditionnel, sinon sacré, et on ne saurait douter qu'il se situe, plus ou moins consciemment, dans la tradition de l'ancien Mali dont il a reçu l'usage de l'estrade sacrée (bembé) 107. L'entretien d'une Cour, même très médiocre, le confirme au moins autant que les coutumes assez variables qui régissaient l'élection. Nous allons nous attacher surtout à celles qui régnaient au Konyã.
A la mort d'un Mãsa, l'intérim était assumé par son porte-parole (dalaaminè) qui ne pouvait menacer les intérêts des autres lignées, puisqu'il n'était pas éligible. Il arrivait aussi que ce fût la tâche du chef (dyõ-kuntigi) des captifs publics (foro-ba-dyõ) car il lui incombait de mettre en sûreté tous les biens du kafu, de peur que la lignée du défunt ne les fasse disparaître. La mort était parfois tenue secrète quelques semaines 108, pour des raisons politiques, bien que l'intérim ne fût pas marqué par une période de licence légale, comme dans certaines « monarchies sacrées », notamment en Haute-Volta.
L'élection avait lieu généralement quarante jours après les premières funérailles (dyãnsa) qui duraient une semaine . Elle incombait à l'assemblée des Tuntigi, à l'exclusion des immigrants récents et parfois des Fula (Haut-Konya) 109.
Les candidats devaient nécessairement appartenir au lignage souverain, et plus précisément à la fraction dont c'était le tour, s'il y avait alternance. On exigeait en outre parfois qu'ils fussent frères ou fils d'un chef ayant antérieurement régné. Dans ces limites, chaque lutigi pouvait être candidat ou bien, s'il se sentait vieux et fatigué, déléguer à sa place un « fils » en pleine vigueur. Les prétendants étaient généralement nombreux car le fait de se présenter, même sans aucune chance, rehaussait leur statut. Chacun d'entre eux prenait la parole pour vanter ses qualité et mettre en valeur ses droits devant les électeurs qui délibéraient ensuite secrètement. Malgré toutes les intrigues qu'on peut imaginer, il semble que, traditionnellement, le choix se limitait aux candidats les plus âgés par respect pour leur sagesse, assurément, mais surtout par crainte qu'un règne trop long n'investisse le commandement dans une seule lignée. La tradition du Konyã signale cependant des chefs choisis pour leur richesse ou leur valeur guerrière.
Contrairement aux « rois, sacrés » de type voltaïque, les Mãsa ne subissaient aucune réclusion durant leur intronisation. Dés que le choix des électeurs était proclamé, celle-ci se déroulait sous la direction du doyen du lignage souverain, ou parfois d'un lignage Tuntigi privilégié, sinon du Maître de la Terre 110. Une procession s'organisait et faisait le tour du village en visitant les principaux lieux sacrés. Deux boeufs y étaient sacrifiés aux ancêtres et la peau du premier servait à recouvrir la tabala qui avait été crevée à la mort du prédécesseur. La seconde peau allait servir au nouveau Mãsa quand il siégerait sur le bèmbé. Dès qu'il se trouvait assis « sur la peau » (gbolo-na) on lui remettait les Régalia, dont le principal était une hache de cérémonie en or ou argent (dyèndé) et on lui présentait la tabala 111. Les captifs, les tuntigi et les fa des autres lignées lui rendaient ensuite hommage en se prosternant devant lui et en se couvrant de poussière. Il prenait alors possession de la concession royale et tenait sa première audience le vendredi suivant, jour où les musulmans lui rendaient visite et priaient pour lui. Le rituel du dègè était rarement employé, sinon par les hégémonies militaires qui ritualisaient ainsi la soumission personnelle des vaincus.
Le nouveau Mãsa choisissait aussitôt un porte-parole (komalasébagha) qui était généralement un griot de confiance. Ce dignitaire devait le conseiller avec la plus grande franchise mais sa charge principale était de répéter fortement à toute séance publique ce que le chef disait à voix basse et de lui communiquer ostensiblement les réponses de l'assistance
Le Mãsa choisissait en outre un dakuñasigila ou portier qui s'installait chaque jour dans le bolõ (vestibule) pour filtrer et annoncer les visiteurs. Ajoutons un griot (dyèli) personnel, chef de file d'une troupe nombreuse, et tout un cortège de forgerons (numun) et d'autres hommes de castes (koroko géomanciens ou finè).
Il héritait par contre des captifs publics (foro-ba-dyõ) et avec eux des biens d'Etat qui échappaient à la succession lignagère du mort. Ces hommes armés lui servaient de gardes et de messagers (kyiden). Ils assuraient aussi la surveillance des magasins et comme ils incarnaient la continuité du commandement, ils acquéraient souvent une grande influence. Dans les grands kafu, où leur nombre était considérable, le nouveau Mãsa ne pouvait révoquer leurs chefs sans procéder à un véritable coup d'Etat.
Si minime que fût cette Cour, son entretien exigeait des ressources sans commune mesure avec celles d'une famille ordinaire. L'organisation des fêtes périodiques et l'accueil de certains étrangers incombaient également au Mãsa. Pour y faire face, celui-ci recevait en tribut (saghalé) 112 un dixième de la production agricole, qu'il percevait chaque année au moment de la récolte Il percevait aussi les droits sur les marchés qu'il contrôlait, et il s'y ajoutait l'usure exigé des Dyula en transit 113. S'il y avait des passages de cours d'eau, il y entretenait des pirogues et la totalité du péage lui revenait. Si ce service était assuré par des Somono, comme sur le Niger de Kouroussa à Bamako, il recevait le dixième de leurs gains, en cauries 114. Les chasseurs devaient lui remettre une défense sur deux s'ils avaient abattu un éléphant, la peau et les griffes si c'était une panthère 115. La poitrine et la patte antérieure des gibiers communs revenaient par contre au chef de la brousse (kõngotigi), ou, à défaut, au chef de village
La moitié du butin de guerre (kõsõ) 116 revenait au Mãsa, mais il s'agissait là d'une recette extraordinaire et aléatoire. Le propriétaire d'un esclave ou d'une bête devait lui verser la moitié de la valeur de son bien si celui-ci était retrouvé sur son territoire. Les vagabonds et le bétail errant lui appartenaient de droit.
Les tõ du kafu se relayaient pour cultiver son champ et entretenir sa concession. Ils procédaient aussi, en saison sèche, à des travaux d'utilité publique qui incombaient aux villages mais dont le kafu contrôlait l'exécution (nettoyage des pistes, réfection des ponts, réparations des fortifications).
Les recettes de justice (amende: nyanni) doivent être considérées à part, car le Mãsa en répartissait la plus grande part entre ses conseillers. Elles passaient cependant toutes entre ses mains, car la fonction judiciaire était ici le critère de la souveraineté comme dans la plus grande partie de l'Afrique. Le Mãsa laissait habituellement les lu et les villages régler leurs affaires internes et n'intervenait que s'ils n'y parvenaient pas. Il y avait cependant des cas spéciaux qui lui revenaient de droit, comme ceux qui opposaient un chef de village à ses sujets et ceux qui entraînaient la peine de mort. Celle-ci devait être exécutée par les captifs du Mãsa, afin de ne pas susciter une vendetta entre les lu. Enfin, toutes les causes opposant des ressortissants de villages différents étaient naturellement traitées au niveau du kafu 117. Aucun plaignant ne pouvait se présenter les mains vides. Leurs cadeaux, comme les amendes, les confiscations et le prix de vente des condamnés réduits en esclavage, revenaient au Mãsa, qui les répartissait à son gré.
Le kafu traditionnel, si important qu'il fût, n'était jamais assez vaste pour justifier une division en commandements territoriaux. Le Mãsa, qui respectait l'autonomie des villages, comme celle des lu, se bornait à suivre de loin le cours de leur vie publique. S'il voulait interroger ou morigéner les dugutigi, il les convoquait et ceux-ci ne pouvaient se dérober sans être taxés de rébellion. Chaque année, au début de la saison sèche, le Mãsa faisait la tournée des villages pour lever le tribut, à moins qu'il fût en mauvaise santé. Il rendait cette hospitalité un peu plus tard, lors du nouvel an animiste (Dyõmbènè) qui tombe dix jours après le solstice d'hiver (au voisinage de notre premier janvier). Tous les chefs de lu, ou leurs représentants, venaient alors lui offrir leurs voeux, et il les hébergeait 118.
Tout ceci montre bien que le Mãsa n'avait rien d'un autocrate, sans répondre pour autant au schéma traditionnel du « roi sacré ». Il est significatif qu'il ne changeait pas de nom au moment de l'intronisation et qu'on s'adressait toujours à lui en l'appelant simplement fa , « père », (va, au Konyã) 119. Samori lui-même n'en demandera pas plus. Le Mãsa n'était nullement inaccessible et il mangeait en compagnie de ses familiers. C'est seulement à l'occasion des audiences publiques que ses visiteurs devaient se prosterner et se couvrir la tête de poussière. Il est significatif que nous ne trouvons ici rien de semblable aux collèges de dignitaires titrés, héréditaires ou non, qui contrôlent le pouvoir des monarques voltaïques.
Le Mãsa est d'abord assisté d'un Conseil personnel qu'il compose à son gré, en y plaçant quelques familiers, mais qui n'a aucun statut précis 120. Les captifs, griots et forgerons y jouent toujours un rôle important. Il siège dans la cour intérieure (du-kènè) et ses avis, bien que sans force contraignante, sont généralement suivis par le chef qui a recours à lui quotidiennement dans ses fonctions judiciaires. Celui-ci est ensuite conseillé par les fa du clan souverain, c'est-à-dire par les tuntigi dispersés à travers le kafu, mais certains peuvent prétendre à sa succession, ce qui limite leur influence. La seule véritable assemblée dont les avis contraignent le Mãsa est celle des horõ qu'il doit convoquer lors des grandes fêtes 121 et à toute occasion grave. On pourrait y ajouter la grande réunion du nouvel an où accourent tous les notables, y compris les nyamakala et les allogènes récemment immigrés.
L'accord des horõ est requis en particulier s'il est question de modifier des règles coutumières, ce que le Mãsa ne peut naturellement pas faire de son propre chef. Les discussions ont souvent lieu en privé, dans sa concessions, mais aucune décision ne peut être prise sans une séance publique, analogue à une audience judiciaire. Le Mãsa s'assied alors sur le bembé, tandis que les notables qui l'entourent, s'abritent sous le hangar à palabres (gba, bãmbélé) avec les griots et conseillers du souverain. Le gbá est toujours construit à l'entrée de sa résidence, en bordure de la place publique (fèrè) où s'assemble le peuple qui ne délibère pas, mais dont l'attitude et les murmures influencent le débat. C'est cette assemblée qui porte le nom de kafu et elle illustre la tradition égalitaire de la société manding, mais il faut souligner que la citoyenneté était limitée aux hommes libres et qu'elle s'investissait dans les lignages, non dans les individus. Tout reposait sur la délibération des fa, foncièrement égaux, qu'ils fussent castés ou non, sous l'autorité du Mãsa. Cette institution est universelle, bien qu'elle adopte le nom de gara en amont de Siguiri et celui de dyamaana chez l'ensemble des Malinke du Sud. Ce dernier est sans doute un héritage du Mali médiéval s'il est vraiment issu de l'arabe djama'at qui sert justement à désigner les institutions démocratiques des Berbères du Maghreb 122.
Cette tradition égalitaire parait avoir été respectée par les Mãsa dans le cadre des kafu traditionnels où l'alternance fréquente des lignées, et la dévolution du pouvoir à des hommes âgés favorisaient l'équilibre des forces en présence. Les coups d'Etats y étaient rares, ce qui les distingue des hégémonies militaires, comme l'Empire de Ségou, dont l'histoire a connu de longues crises intérieures.
Le kafu, enfermé dans son territoire étroit et bien délimité, n'était évidemment pas de même nature que les Etats conquérants auxquels il rendait hommage, de bon ou mauvais gré. Il ne faut pourtant pas en conclure que sa fonction militaire était secondaire. Sa capacité à assurer l'ordre et la sécurité était au contraire l'une de ses raisons d'être, et le principal frein aux tendances séparatistes des villages Il était cependant organisé pour la défense, non pour l'attaque, car l'idée d'expansion territoriale lui était étrangère. Le conflit armé entre les kafu était institutionnalisé: il visait à rétablir un équilibre et nullement à la destruction de l'ennemi.
Un petit kafu ne possédait à vrai dire aucune troupe permanente, sinon quelques captifs armés qui servaient de garde au Mãsa (foroba-dyõ) 123. Les plus riches en faisaient le noyau d'une véritable armée qui comptait alors aussi bien des esclaves que des hommes libres, recrutés parmi des aventuriers déracinés. Ceux-ci étaient alors payés et équipés par le souverain auquel ils étaient personnellement dévoués. Ces combattants étaient presque toujours des fantassins, du moins chez les Malinké du Sud, bien qu'ils portassent le nom paradoxal de sofa (« père du cheval ») 124 . Ils permettaient au Mãsa d'éliminer les brigands qui sévissaient dans les déserts frontaliers. Ils pouvaient aussi lui inspirer la tentation redoutable de transformer sa prééminence coutumière en autorité absolue, voire de se lancer dans des guerres de conquête et de se transformer en Faama. Ces armées permanentes, riches en éléments serviles, étaient foncièrement contraires à l'esprit du kafu. Le Mãsa qui en organisait une, pouvait ainsi échapper à la tutelle des tuntigi, mais c'est qu'il préférait alors l'aventure à la tranquillité et les fondements de son nouveau pouvoir risquaient de s'avérer peu sûrs. C'est ce qui arriva à Ségou 125 .
La véritable armée coutumière était d'une autre nature. Elle provenait de la levée de tous les hommes valides dans le cadre des kari dont chacune, selon son âge, se spécialisait dans l'assaut, les combats ordinaires ou la garde des villages. Une telle levée ne pouvait être ordonnée qu'à titre exceptionnel en vue d'une colonne de courte durée ou pour repousser une invasion. On évitait d'y recourir à l'époque des cultures. Le Mãsa ne pouvait d'ailleurs en décider qu'en gara. Comme il ne combattait jamais lui-même, en raison de son âge et de sa dignité, il nommait un ou plusieurs kèlètigi, maîtres de la guerre ou plutôt chefs de colonnes. Son choix se fondait en principe sur la valeur et la popularité du candidat, mais il n'avait pas à s'en expliquer et pouvait suivre ses préférences personnelles. Le tirage au sort que Meillassoux signale pour Bamako n'était nullement la norme. Les pouvoirs des kèlètigi étaient en tout cas purement militaires et expiraient en fin de campagne quand les hommes rentraient chez eux.
Les chasseurs (dõzo) formaient un corps spécial, avec un chef élu, car la sûreté de leurs flèches ou leur familiarité avec les armes à feu, en un temps où elles étaient encore rares, en faisaient des combattants précieux.
Les ancêtres étaient naturellement mobilisés aux côtés des vivants. Dans le Konyã et le Mau, chaque kafu gardait précieusement le crâne d'un guerrier célèbre, orné de cornes de buffles et somptueusement paré car il se trouvait chargé de forces occultes (kèlé-séli). Le combattant le plus brave le portait sur la tête au premier rang et la lutte était toujours chaude pour prendre et défendre ce trophée. Les Kurãnko y substituaient généralement un bras droit momifié dans une gaine de cuir.
Le partage du butin était l'apanage du Mãsa qui en conservait la moitié. Pour éviter les contestations, il y procédait en compagnie des principaux lutigi.
Nous ne pouvons insister sur cette organisation militaire dont l'étude détaillée sera faite plus loin. Il suffit de souligner ici l'aptitude du kafu à mobiliser un assez grand nombre d'hommes car cette fonction militaire est un élément de sa personnalité. Il inspire à ses enfants un patriotisme étroit mais fort d'où découle une vitalité surprenante. Il survit aux pires tourmentes de l'histoire. Ravagé par la guerre, réduit à l'état de désert, il finit toujours par se reconstituer. Que quelques survivants échappent à la captivité, ils reviennent aussitôt aux tombes des ancêtres ct reconstruisent le village. Cette fidélité est à vrai dire universelle dans le monde noir et ne distingue pas spécialement le kafu. Celui-ci a l'originalité d'être un véritable Etat, ce qui l'oppose aux formules politiques des ethnies voisines, malgré certaines transitions que nous allons passer en revue.
Nous pouvons négliger les « anarchies » paléonégritiques, où la vie publique se confond avec le tissu des relations lignagères et culturelles. Elles sont fréquentes sur la Volta mais les Samoriens n'atteindront leur domaine qu'en 1895. Les Sénufo, qui appartiennent à la même province culturelle, représente un autre niveau car leurs villages, parfois énormes, sont déjà des communautés fondées sur le territoire autant que le lignage. Plusieurs d'entre eux forment une terre (tar) qui est une aire de paix et d'arbitrage, mais il n'y a pas d'hégémonie politique et militaire en dehors des influences dyula.
Si nous nous tournons à présent vers la Forêt, nous trouvons chez les Kisi une organisation analogue à celle des Sénufo mais fondée sur des villages minuscules, moulés étroitement sur les lignages et groupés en d'étroites aires d'arbitrage 126. La plupart des peuples Kru, au coeur de la Forêt, se rattachent à ce type, mais leurs groupements sont un peu plus vastes. L'administration (coloniale) française les a bizarrement qualifiés de « tribus » et celle du Liberia de « clans ».
Les Mandé de la Forêt nous font aussitôt accéder à un nouveau palier car leurs unités fondamentales, comme le kènyè des Kono ou le zu des Toma, sont fondées essentiellement sur la prédominance du lien territorial, ce qui entraîne l'apparition d'une autorité politique distincte de celle des lignages et pourvue de quelques moyens d'exécution. Un chef Toma fait à l'occasion des tournées dans son territoire et il entretient une petite cour 127. Il n'est pas foncièrement différent d'un Mãsa. L'étude des Dã suggère d'ailleurs que ces institutions sont dues à l'influence malinké car ceux du Nord connaissent bien des unités de ce type, les sé, mais ceux du Sud , comme leurs parents Guro, ont une société acéphale, fondée exclusivement sur les liens lignagers et dont seuls émergent certains chefs de guerre.
Les commandements forestiers, même les mieux structurés, restent d'ailleurs privés d'un élément qui nous paraît fondamental et qui atteste seul le caractère étatique du kafu: l'existence d'un noyau d'hommes et de biens (foroba) qui assure la continuité de la chefferie et qui exige un tribut régulier pour son entretien 128. Ce critère n'est pas absolu et il ne coïncide pas exactement avec le monde manding puisqu'il exclut certains Bambara, comme ceux du Baninko, mais inclut une grande partie des Dyalonké et des Susu. Nous pensons cependant qu'il est acceptable pour cette partie de l'Ouest africain, si nous gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un simple procédé de classement.
Tout en fondant leur société sur une solide structure lignagère, les Manding paraissent donc se distinguer par leur conception d'une vie politique autonome. Sur ce plan, la distinction entre biens de famille et biens d'Etat est essentielle. Samori la consacrera dans le cadre de son administration centralisée. Il pourrait s'agir là d'un héritage du Mali médiéval si l'on admet que les chefs coutumiers se sont substitués aux gouverneurs (farin), et que ceux-ci maintenaient l'unité de l'Empire au moyen de biens et d'hommes indépendants des lignages locaux.
Si le kafu est un Etat, il faut pourtant admettre qu'il est réduit au minimum. L'absence de toute organisation territoriale s'explique par son exiguïté. Certains n'excèdent pas dix kilomètres de diamètre, surtout en pays bambara ou sur la frange forestière 129, et d'autres sont à moitié déserts même s'ils s'étendent sur 60 ou 80 kilomètres (Kulay-ni-gwala dans le Torõ de Kankan). Nous n'en avons cependant rencontré aucun qui comptât moins d'un millier d'habitants répartis en 3 ou 4 villages 130. A l'ère précoloniale, les plus considérables, comme le Sanãfula (Wasulu de Kankan) ou le Tyendugu (Bougouni) ne devaient pourtant guère dépasser le chiffre de 15.000.
Ce cadre étroit s'accommodait d'une histoire au rythme lent, enfoncée dans un traditionalisme paisible. La société manding a cependant connu des crises qui exigeaient une plus grande échelle et il en est resté des traces
C'est ainsi qu'on peut identifier des groupes de kafu dotés d'une personnalité commune qui s'incarne dans un nom, un parler et une espèce de patriotisme, car tous sont issus de la segmentation d'un même clan souverain et occupent un territoire cohérent. Tel est le cas du Konyã, terre natale de Samori, car ce pays, comme création des Kamara, est conscient de son unité malgré son morcellement en une trentaine de kafu 131. La géographie a imposé la distinction entre haut et bas Konyã 132, mais elle n'empêche pas tous les descendants de Ferén-Kamã d'envoyer chaque année des délégués au village de Musadugu pour renouer leur solidarité.
On pourrait en dire autant du Kurãnko, du Torõ ou du Wasulu. Le Sãnkarã marque un degré supérieur de complexité car il met en jeu des Tuntigi Traoré ou Ularè à côté des Kõndé et unit trois territoires
Chacun de ceux-ci compte plusieurs kafu et bloque à son niveau les sentiments de patriotisme.
Il est remarquable que la langue malinké ait peine à définir ces vastes ensembles en regard de la réalité bien définie des kafu. Elle leur réserve généralement le nom de dyamaana, ce qui crée une certaine confusion puisque ce terme d'origine sémitique est admis au départ comme équivalent du kafu autochtone. Sa valeur sémantique suggère une assemblée, plus ou moins démocratique, si bien qu'il ne peut s'agir d'un avatar des grands gouvernements du Mali médiéval 133.
Il faut donc admettre que les groupements de kafu n'ont guère besoin d'être définie car ils ne forment pas des unités organisées. Ils n'ont ni gouvernement ni chefs et les guerres intestines sévissaient en leur sein. Il arrivait pourtant, mais assez rarement, qu'ils reconnussent une primauté d'honneur à l'un d'eux, comme celui de Dwako dans le Kondédu. En face d'une menace étrangère ils savaient cependant, à l'occasion, faire bloc. Comme ces nébuleuses de kafu marquent encore sur la carte les grandes migrations de la fin du Moyen Age, on peut admettre que nous sommes en face d'une construction étatique avortée.
D'autres structures transcendant les kafu s'imposent à l'observateur par leur caractère spectaculaire, mais elles se situent sur un autre plan. Nous voulons parler de l'apparition fréquente d'un Faama qui établit une hégémonie militaire et étend son domaine aussi loin que possible, sans souci des frontières coutumières. Il s'agit cette fois d'une rupture de l'ordre établi car la guerre de conquête se substitue aux conflits institutionnalisés qui règlent les relations des kafu.
La tradition permet de reconstituer la carrière d'un certain nombre de ces conquérants. Ce sont rarement des Mãsa qui ont osé rompre avec la tradition mais, plus souvent, des Kèlètigi heureux qui ont éclipsé ou destitué leurs chefs légitimes. Nous soupçonnons parfois derrière eux un puissant mouvement populaire comme celui qui lança Kondé Bréma contre les musulmans du Fuuta-Dyalõ (vers 1750) ou encore une crise religieuse, comme la « guerre des fils du rêve » (Sugoden-Kèlè) que dirigea le Wasulunké Dyèri Sidibé au milieu du XIXme siècle.
Quoi qu'il en soit, un Empire ainsi édifié en peu d'années reste inorganique, sans structures territoriales: ce n'est qu'une collection de pays soumis. Dès la chute de son fondateur il disparaît, sans laisser de traces dans les institutions, sinon dans la mémoire des hommes.
Chaque kafu, après avoir plié la tête, reprend alors sa liberté et le cours de sa vie routinière. Cette histoire monotone, faite de perpétuels recommencements, se trouvait à l'aise dans la zone préforestière, à distance respectueuse des foyers de la civilisation soudanaise aussi bien que des comptoirs européens. Sur l'axe du Niger, au contraire, les structures étatiques ne disparaissent jamais tout à fait et les révolutions peules des XVIIIme et XIXme siècles ont donné aux événements un tout autre rythme. La société des Manding du Sud ne pouvait cependant poursuivre ses antiques errements que dans la mesure où elle préservait son isolement. Dès le milieu du XVIIIme siècle, l'apparition d'une monarchie stable, centrée sur Odienné, à portée de la Forêt, annonçait des temps nouveaux.
La civilisation dont nous venons de brosser un portrait rapide est celle des Manding méridionaux, établis au sud de la ligne Siguiri-Bougouni-Sikasso. Dans ces limites, elle n'est stabilisée que depuis le XVIIme siècle et des mouvements d'ajustement se sont poursuivis jusqu'à la veille de la conquête coloniale. Le passé de cette région n'ayant jamais été étudié, il convient d'en indiquer brièvement les grandes lignes en nous fondant sur les traditions orales puisque, jusqu'à ce jour, l'archéologie ne s'est pas manifestée 134.
Malgré leur proximité des centres politiques du Mali, ces pays paraissent avoir largement échappé au peuplement manding durant le Moyen Age européen. Leurs franges septentrionales acceptèrent sans doute la suzeraineté politique des Empereurs Kèita, mais celle-ci ne devait pas traverser la zone de pauvreté des 10 et 11e parallèles. Celle-ci était le théâtre de razzias d'esclaves contre les païens du Sud que les auteurs arabes appellent Lamlam et les premiers marchands de kola avaient sans doute d'autres soucis que la diffusion de la civilisation soudanaise. Les mines d'or du Burè, qui gardaient une certaine autonomie, étaient peuplées de Dyalõnké, ancêtres de la population actuelle. Les « Bambara » qui tenaient le triangle Siguiri-Kankan-Kouroussa et s'étendaient assez loin vers la Forêt, appartenaient peut-être au même groupe ethnique. Plus à l'est, de vrais Bambara occupaient sans doute déjà la région de Bougouni et le Baninko.
Tous ces peuples pratiquaient une agriculture peu différente de celle d'aujourd'hui et ils s'ouvraient lentement au commerce à longue distance introduit par les dyula.
Plus au sud, la grande sylve couvrait toute la dorsale et la zone préforestière, mais non pas les savanes subsoudanaises. S'il se confirme que celles-ci formaient une marche semi-déserte, elles devaient être alors revêtues de forêt claire. Les peuples forestiers, bien que dépourvus de plantes américaines, pratiquaient une agriculture itinérante assez pauvre (igname, riz de montagne) et la chasse devait garder une grande place dans leur économie. Les Kisi tenaient sans doute une grande partie du Haut-Niger 135, tandis que les ancêtres linguistiques des Toma occupaient la vallée du Milo en amont de Kankan et ceux des Guèrzè le Konyã, peut-être même une fraction du Wasulu. Ceux des Dã et des Guro se trouvaient sans doute plus à l'est, entre Touba et Odienné 136. Les Sénufo paraissent avoir tenu alors la région d'Odienné, avec des avant-gardes proches de Kankan, mais il est douteux que leur position générale ait été plus septentrionale qu'elle ne l'est aujourd'hui 137.
Cette stabilité relative allait être bouleversée par une immense poussée vers le sud du peuplement malinké, qui traversa la zone intermédiaire, recouvrit les franges préforestières, sur le piémont de la dorsale, et déboucha même, à l'occasion, sur les côtes de l'Atlantique. Des recoupements européens nous permettent de dater avec précision les phases finales de ce mouvement dans le courant du XVIme siècle. Il embrasse cependant plusieurs vagues successives et la tradition ne permet pas de déterminer l'époque de ses débuts. Divers indices nous portent néanmoins à croire qu'il est postérieur à l'apogée du Mali car celui-ci préférait sans doute se consacrer aux grandes aventures du nord, aussi longtemps qu'elles furent possibles. La colonisation des terres du sud n'aurait alors été qu'un pis-aller pour les kèlètigi de l'Empire décadent. Il est en tout cas certain qu'il s'agit d'une conquête brutale et l'anthropologie parait confirmer qu'il y eut substitution d'un peuplement à un autre, du moins dans les premières phases. Les envahisseurs étaient des « soninké » ou « sacrificateurs », c'est-à-dire des guerriers animistes faiblement imprégnés des traditions impériales du Mali. Leurs hégémonies allaient être éphémères car leurs descendants morcelèrent très vite les immenses territoires conquis en kafu minuscules. L'Islam et le commerce à longue distance étaient déjà intégrés à leur culture mais en tant qu'éléments accessoires et marginaux. L'apparition imprévisible des Européens sur la Côte Atlantique, en leur présentant de nouveaux objectifs, allait pourtant relancer un mouvement qui touchait déjà à sa fin.
On peut isoler une première vague, elle-même complexe, que nous daterions volontiers du XVme siècle. Elle a porté en avant des masses dirigées par des lignées Kondé, Kuruma et Konaté et celles-ci ont dégagé la vallée du Niger jusqu'à Farana, en rejetant dans l'Ouest les Dyalõnké qui allaient tenir le Fuuta-Dyalõ jusqu'au XVIIIme siècle.
Kisi et Toma reculent alors également mais les Guerzé se maintiennent dans le Haut Konyã tandis que les Malinké ne dépassent pas la ligne générale Faranah-Kerwané-Odienné. Ils posent les fondements du Kulõnkalã, du Sãnkara et du Torõ 138, puis repoussent les Sénufo dans l'est, mais ces derniers sont parvenus à assimiler les avant-gardes des conquérants 139.
La tradition discerne une seconde vague, qui pourrait se situer au tournant des XVe et XVIe siècles 140. Comprenant certains Kèita, des Ularè, des Mara et surtout des Kamara, elle a d'abord déferlé vers les sources du Niger 141. Débouchant sur l'Atlantique elle a mis en place les Kono dans leurs montagnes et les Vai sur la mer, au contact des Européens.
Les Kamara ont ensuite poussé vers le sud-est avec divers groupes d'importance secondaire qu'ils ont entraînés jusqu'aux franges de la Forêt et ils ont occupé les plateaux salubres du Konyã dont le climat et les savanes séduisaient ces Soudanais. Dans le Mau, en contrebas, ils étendirent rapidement leur occupation aux dépens des Dã jusqu'aux rives du Sassandra (XVIIme siècle) 142.
Faut-il voir là une troisième vague ? Toujours est-il qu'ils sont vraisemblablement à l'origine de l'invasion Sumba qui a déferlé sur la côte atlantique entre 1540 et 1545, submergeant d'abord le Libéria occidental (Vallée du Saint-Paul) puis toute l'actuelle Sierra Leone.
Dans l'Hinterland de ce pays, mais plus au nord, les Mara, installés dans le Koinadugu, avaient servi de catalyseur au peuple Kuranko. Contenus par les Dyalõnké, ils se lancèrent aux XVIIme et XVIIIme siècles dans une surprenante expansion, aux dépens des Kisi et des Toma' jusqu'aux frontières du Konyã où ils furent bloqués par la résistance des Kamara 143.
Ces derniers avaient pénétré dès le XVIIme siècle dans la vallée de la Lofa. Au XVIIme siècle, ils éclipsèrent les Toma du Haut Dyani tandis que d'autres groupes enlevèrent le Karagwa aux Guèrzè et poussèrent jusqu'au Bafing dans le Mau. De ce côté cependant, la pénétration du Pays Dã en direction de Man ne commença pas avant le début du XIXme siècle 144.
Ce n'étaient là que des mouvements de détail car la stabilisation se trouvait justement facilitée par la diffusion des plantes américaines (maïs, manioc). L'économie de la Forêt occidentale en fut alors bouleversée tandis que celle du Soudan demeurait immuable. Les Malinké du Sud sauront profiter de cette révolution et surtout ceux du Konyã dont les hautes terres allaient attirer de nombreux Fula avec leurs immenses troupeaux de boeufs.
Il en allait autrement dans l'Est où l'on trouve une poussière de lignées mêlant des guerriers animistes (tungiti ou sohõndyi), des commerçants (dyula) et des musulmans (silama) qui ont submergé, durant le XVIIme siècle, les autochtones Sénufo, Kru ou Guro, entre Sassandra et Bandama. Ils y ont rencontré des éléments Dyula venus de Djenné par Bobo et le Haut Comoé et ont sillonné le golfe de savanes qui n'était pas encore la patrie des Baulé. Ils paraissent même avoir poussé jusqu'à la mer, en descendant le Bandama. En se stabilisant, ils ont donné naissance au Worodugu de Séguéla, au Koyaradugu de Mankono et dans une moindre mesure au Koro. Sur le Comoé, le Dyammala est issu d'eux et ils participeront au XVIIIme siècle, à l'aventure impériale de Kong.
Dès lors tout était en place. Diverses tentatives d'expansion en pays sénufo n'aboutirent qu'à des hégémonies éphémères, mais des Bambara, sous les ordres d'une lignée Dyarasuba, allaient implanter le royaume du Nafana au milieu du XVIIIme siècle, dans le pays d'Odienné. Ils assureront t ainsi la garde d'une des principales pistes du kola.
Les vagues de l'expansion malinké nous ont entraîné loin du vieux Manding d'où elle était issue. Quand l'Empire se disloqua, aux XVIme et XVIIme siècles, des lignées Kèita se partagèrent son dernier noyau, entre Kaaba (Kangaba), Siguiri, Nyagasola et Kita. Les pays de la rive droite avaient été ravagés par de puissantes invasions peules, venues du Masina et du Fuuta-Dyalõ.
Rejetés derrière le Sankarani au début du XVIIme siècle par les Kèita, qui organisèrent alors le Dyuma et le Dyumawañya, ces envahisseurs s'assimilèrent totalement aux Bambara autochtones, donnant naissance au peuple Wasulunké. C'est de là qu'ils partirent au XVIIIme siècle pour aller fonder le Fuladugu de Kita. L'un d'eux, Kondé-Brèma, allait soulever un instant tous les animistes du Haut Niger contre la théocratie peule qui s'était substituée, à partir de 1729, au morcellement des Dyalonké du Fuuta-Dyalõ et qui y développait un Islam original 145.
Les Kèita du haut Fleuve allaient se rallier à la cause des Bambara et ils connurent une certaine puissance à la fin du XVIIIme siècle avant de tomber sous l'hégémonie des Dyalonké de Tamba (XIXme siècle).
Le Mali originel s'étant lui-même morcelé, on ne saurait s'étonner que la vague qui portait ses fils vers le sud ait donné naissance au lieu d'un Empire, à un nombre considérable d'unités minuscules, repliées sur elles-mêmes, et qui le resteront, à l'exception de brèves secousses. La géographie y a d'ailleurs contribué. Le nouveau domaine que s'étaient taillé les Malinké du Sud, butait entre le Haut Niger et le Bandama, contre le mur impénétrable de la Forêt. C'est seulement dans l'Ouest, de Kankan aux Rivières du Sud, et dans l'Est, sur le Bandama, qu'il débouchait finalement sur la mer. La seconde issue fut d'ailleurs obturée par l'invasion Baulé dès l'aube du XVIIIme siècle, tandis que les tentatives pour percer au centre, sur le Lofa, n'aboutit guère. Les Malinké se voyaient ainsi bloqués dans un gigantesque cul-de-sac, relativement à des influences européennes que la traite des Noirs diffusait sur la Côte. Ils se trouvaient fort loin de l'axe historique du Niger et des Savanes du Nord dont ils étaient séparés par les semi-déserts de la zone intermédiaire. Tout se liguait donc pour les enfoncer dans la région d'une histoire sans perspective, peu différente de celle des Forestiers qu'ils avaient refoulés.
Le rythme lent de cette vie allait pourtant s'accélérer assez brusquement au XIXme siècle sans qu'une intervention extérieure puisse être mise en évidence.
Si nous voulons essayer d'expliquer ce phénomène, il convient de chercher, dans la monotonie des siècles précédents, quels étaient les facteurs sociaux et culturels qui préparaient une ère de relations plus active et ouverte au vaste monde extérieur. Bref, quels étaient les hommes et les institutions qui gardaient quelque chose du rythme historique du Mali et pouvaient préparer le terrain à de nouvelles aventures ? Il ne peut s'agir bien entendu que du commerce et de l'économie dont nous avons volontairement écarté l'étude jusqu'ici.
Notes
1. La triple cicatrice verticale serait, d'après Monteil (1924), la marque des captifs du royaume de Ségou qui aurait été diffusée par snobisme. Les cicatrices des lignées nobles chez les Malinké du Sud (Kamara) aussi bien que chez les Dyula (Wattara) sont pourtant les mêmes. ll est en outre peu vraisemblable que les Kèita aient imité les Kulibali au XVIIIme siècle. Je croirais plutôt qu'il s agit d'une ancienne marque des Mãsasi, remontant peut-être à l'époque du Mali.
2. Devant de tels cas, la nomenclature est en défaut. Préoccupés essentiellement de faits culturels, nous préconisons l'emploi du nom de Peul (désignation wolof de Pullo) pour les groupes ayant gardé l'usage de la langue Pular, et du terme manding Fula pour désigner les Peuls ayant adopté le manding. C'est le nom que ceux-ci emploient pour se désigner eux-mêmes.
Le professeur Pales a eu la même idée, mais l'anthropologie physique lui a suggéré une solution différente. ll réserve le nom de Peul aux groupes ayant gardé un aspect racial éthiopien ou soudanien, celui de Fula à ceux qui se rattachent plutôt à la sous-race guinéenne. ll en résulte que les gens du Fuuta-Dyalõ, qui est l'un des principaux centres de la langue et de la culture Pular, mais où le substrat guinéen a marqué la race, sont qualifiés de Fula. Inversement, les gens de la région de Kita, qui ne parlent que Bambara et se désignent eux-mêmes par le nom de Fula, sont qualifiés de Peuls parce qu'ils ont gardé le type racial originel (Pales, 1953, p. 240- 4).
L'opposition des termes Peul et Fula étant d'ordre linguistique, nous maintenons notre point de vue.
3. L'anthropobiologie est très prometteuse pour les historiens, mais les données disponibles sont encore . Le faible taux de siklémie des petites races des Rivières et de la plupart des Kru confirme leur ancienne implantation dans un milieu Forestier. Le taux très fort des Malinké indique au contraire un ancien contact avec paludisme en zone soudanaise.
4. La quatrième, dite Guinéo-Camerounaise, est voisine de la sous-race Congolaise. Samori n'allait la rencontrer qu'en 1895, en pays Kulango. Elle est caractérisée par une forte mésocéphalie, exceptionnelle en cette région de lichocéphale. une taille assez faible (mésosomes) et des jambes relativement courtes (métriokormes).
5. ll l'a fait dans une certaine mesure puisqu'il distingue les Kurãnko et les Konyãnké qui sont, du point de vue ethnologique, des variétés de Malinké. Par contre, il ne traite pas séparément les Sãnkarãnké ou les Torõnké. On est surpris de trouver une mention des Malinké de Beyla sur leurs tables des valeurs (p. 346). Comment définir en effet un Konyãnké sinon comme un Malinke du Konyã, c'est-à-dire du cercle de Beyla ? S'agirait-il des musulmans du Haut Konyã ?
Pales paraît enfin avoir manqué de données sur les Malinke de Côte d'lvoire où les Mauka figurent sous le nom de Dyomandé. ll aurait été prudent de laisser leur territoire en blanc. Le visiteur, en tout cas, a l'impression qu'ils sont nettement plus petits que les gens du Haut-Niger.
6. Parmi les principaux généraux de Samori, Bolu-Mamudu, originaire du Wasulu, était renommé pour sa haute taille, ses jambes courtes et son teint fort noir.
7. Voici les tailles moyennes qu'indique Pales:
| Kisi de Guékédou | Kisi de Kisidougou | Toma | Konyãnké | Kurãnko | Malinké en general | Maninké du pays Toma (Macenta) |
Maninké de Beyla Haut Konyan |
Malinke de Kankan à Siguiri | Bamako |
| 165,5 | 166,2 | 167,3 | 168,5 | 166,2 | 170,8 | 167,6 | 171,6 | 170,6 | 173,9 |
Les Malinké de Macenta (Maninka du pays Toma) font seulement 167,6. Ceux de Beyla (musulmans du Haut Konyâ) font 171,6 soit plus qu'au coeur du pays Malinké, de Kankan à Siguiri, où on trouve 170,6. La taille devient très forte dans le vieux Manding, en amont ce Bamako: 173,9.
Les chiffres des Malinke doivent être comparés à ceux des Bambara dont l'ensemble a une taille moyenne de 171.5. Ici encore, cette moyenne est relevée par les fortes statures du Nord. Vers Odienné, ils mesuraient seulement 168,5. Les régions qui nous intéressent sont celles de Bougouni, avec 171,2 et de Bamako avec 172,7
Les Wasulunké ne mesurent que 167,8, ce qui paraît faible, mais il faut considérer que leur élément Peul est originaire, en grande partie, du Fuuta-Dyalô où la taille n'est guère plus forte (168,8). Les Fula de Kita mesurent par contre 172,3.
8. Pour la linguistique ouest-africaine, les ouvrages classiques de Westerman (1950 et de Lavergne de Tressan (1952) demeurent nécessaires, quoique vieillis. La classification sera faite d'après Greenberg (1963). Pour l'état actuel des questions, on se reportera à African Language Studies de l'Université de Londres, au Journal of West African Languages et à la Sierra Leone Language Review (travaux de Dalby).
9. Nous suivons donc l'exemple déjà traditionnel de Delafosse et Labouret, mais en renonçant à la francisation du nom en Mandingue. Nous suggérerions volontiers à Houis d'employer la forme authentique mãnduñka, et non l'anglicisation mandingo pour désigner le dialecte occidental (Gambie - Casamance)
10. Encore ne tenons-nous pas compte des extensions récentes Un nouveau dialecte malinké, qualifié de tagbusi-kã (langue des métis) est actuellement la langue africaine usuelle d'Abidjan et le dyula fait concurrence au hausa jusqu'à Accra, dans les milieux commerçants et islamisés.
11. L'uniformité du monde bantu se situe à un autre niveau. Les langues de ce groupe, qui occupe une bonne moitié du continent, présentent une unité structurelle remarquable. Leur parenté génétique est évidente, mais elles sont très nombreuses et le foisonnement des parlers est dans certaines zones aussi grand que sur la Volta. Le fait que tous soient bantu ne diminue pas l'impuissance des locuteurs à se comprendre.
12. C'est la sous-famille 1 A2 de Greenberg qu'il inclut à côté du bantu (1 A 5: Benué-Congo) dans la grande famille Niger-Congo (1 A) regroupée elle-même avec les langues du Kordofan (Soudan Oriental) (1: Congo Kordofanian) (Greenberg, 1963, p. 6-9).
13. Le professeur Portères a démontré l'existence de ce berceau dans des travaux désormais classiques, a hésité longtemps à identifier aux Mandé les auteurs de cette révolution. La position géographique du delta central au Niger et la position des langues mandé dans l'ensemble africain donnent pourtant une force extrême à cette hypothèse.
14. Le professeur Welmers a dressé en 1960 un bilan de ses travaux dans un article destiné au Hartfort Seminary Foundation (The Mandé Languages).
Pour les méthodes de la glottochronologie, on se reportera à l'article de Hymes (Lexicostatistics so far ? Current Anthropology, 1960). Cet auteur expose la position classique de Swadesh, qui est fortement contestée.
15. B. Holas (1962) souligne cependant chez les Tura des traits culturels évoquant le groupe Guerzé-Konor. Ceci ne doit pas interférer dans la classification linguistique, pour laquelle nous suivons le R. P. Prost (1953, p. 53)
16. Le mwã (mona) est une langue très proche du kwéni (guro) et se localise comme lui au sud de Mankono (Côte d'Ivoire).
Le gagu est parlé prés d'Oumé sur le Bas Bandama. Le gã dans l'Ano, près de la Comoé (subdivision de Mbahiakro) et jadis dans la région de Bondoukou.
17. Nous appelons Konor cette sous-ethnie Guerzé (cercle de Nzèrèkoré) pour la distinguer des Kono de Sierra Leone dont il sera question plus loin.
18. Gordon Innes rattacherait pourtant directement le loko au gbandi (AfricAn Language Studies. V Londres. 1964).
19. Nous négligeons le fait que certains Guro, comme certains Toma, débordent effectivement des limites de la Forêt.
20. Les recherches de Dalby (1965) conduisent à séparer le groupe mèl (Lãnduma, Nalu, Baga, Témnè, Kisi, Gola) de la famille ouest-atlantique qui est désormais limitée aux Peuls, Wolof, Serér et aux petites ethnies de Guinée Bissau mais aussi, chose curieuse, du Limba. La dernière édition de Greenberg ne tient pas compte de ce bouleversement (1963, p. 8).
21. Houis vient de nous donner une remarquable étude descriptive du susu (1963), mais l'historien le taxera de prudence excessive sur le plan des hypothèses diachroniques qui lui sont nécessaires. Sans contester l'ensemble du système de Welmers, que nous suivons ici, Houis inverse la position relative du soninké et du susu (sosokui) dans la famille manding. Le premier est plus éloigné que le second de la souche commune, ce qui donne à croire que Welmers a travaillé, sur des matériaux insuffisants.
22. Avant El Hadj Omar, c'était la langue du pays de Dinguiraye et on la parle encore dans le canton de Kèla.
23. Sur le Haut Tenkiso, autour de Tumaniya, quelques îlots restent cependant fidèles au dyalõnké et l'étaient à plus forte raison au XIXme siècle.
24. Nous employons ici le nom de Soninké, que les intéressés se donnent à eux-mêmes. Il fait cependant confusion avec un terme Malinké presque identique, Suninké ou Soninké, qui vient de la racine sõ « sacrifier » et qui désigne les animistes entre la Casamance et le Haut Niger, comme le mot Sohõndyi dans la région de Kong. Pour éviter tout malentendu, nous désignerons désormais les Soninké sous le nom de Sarakholé (Hommes rouges) qui serait d'origine peul, mais que les intéressés utilisent eux-mêmes sur le Haut Sénégal.
25. En dernier lieu, ma contribution à « The historian in Tropical Africa » (1962).
26. Le bambara couvre en effet tout le nord-est du cercle d'Odienné (Folo, Bodugu, Torõ, Tadugu, Fuladugu, Vadugu). Il est d'ailleurs en recul au profit du parler d'Odienné, que ses usagers qualifient de maninkakã.
27. Les musulmans de Touba parlent d'ailleurs à la façon de Kankan depuis le siècle dernier.
28.
| Malinké |
sens | Koyara |
| Usugula | nom de village | Usuwa |
| bolo | main | boo |
| Fofana | dyamu | Fofã |
29. Bien entendu, cette segmentation n'est pas automatique. Elle n'a lieu que si l'effectif du lu grossit excessivement. Sa dimension moyenne varie d'ailleurs d'une région à l'autre : elle est d'une cinquantaine de personnes dans le Konyã. Inversement, un lu qui dépérit fusionne fréquemment avec des parents plus prospères.
30. C'est aussi le cas des Sénufo Nafagha de Sinématyali qui sont matrilinéaires et dont beaucoup de ménages sont matrilocaux. Mais ils n'intéressent Samori qu'après 1894.
31. Définition de Delafosse H. S. N. III, p. 98 à 109. Leynaud (1967) emploie le mot tribu pour désigner notre clan et le mot clan pour le lignage maximal (p. 37-39). Je rejette cet usage car je conserve au premier mot, là où je l'emploie, une signification politique. Il faut déplorer que Monteil, dans ses travaux si remarquables sur les Khasonké (1915), les Bambara (1924) et les Malinké (1929) ait utilisé le mot clan pour traduire to (association) et désigné ainsi l'appareil étatique des Empires Malinké et Bambara. C'est un abus de langage, d'autant plus regrettable que l'auteur confond en outre sous ce nom deux processus politiques très différents: le rassemblement d'un Empire par une lignée heureuse à partir d'un kafu initial et la prise de pouvoir par une caste militaire d'origine servile.
Par ailleurs tuñ, équivalent de tõ, désigne chez les Khasõnké (Fula du Haut Sénégal) les biens indivis du lu gérés par l'association de ses membres. Le lutigi prend alors le nom de tuñtigi qui n a rien de commun avec la classe noble des Malinké du Sud (Monteil, 1915, pp. 282-298).
32. Sur le dyamu on se reportera à Labouret (1934) P. 113) et à Zahan (1945. p, 29).
Nous acceptons ici l'étymologie de Zahan
dya = double, mu = peindre peinture, embellissement du dya.
L'énoncé du dyamu excite le nyama (force vitale) de l'individu. Il correspond au premier mot de la devise: Kulubali, kuludyã tè suma.
Kulubali, la haute montagne qui ne s'affaisse pas
Zahan. 1965, pp. 136-371. Il y a généralement équivalence de plusieurs dyamu, l'un d'eux, variable d'une région à l'autre étant réservé aux occasions solennelles. C'est ainsi que
| Bérété = Savané |
| Kamara = Dyomandé = Séwa |
| Kondé = Tamura = Farama = Baro |
| Kèita = Mãsarè = Dyimési = Siko |
| Kuruma = Dumbuya = Saano |
| Konaté = Dyènènka = Sonoo = Kamãnka = Saminka |
| Saganago = Sendoka |
| Traorè = Dèmbèlé = Dao = Turama |
| Swarè = Sèmbasi |
| Turè = Situru |
Le nom secondaire est souvent appelé si (semence) d'après le suffixe servant à former les nome de lignées (kulibali = mãsasi). La politesse précise quand il convient d'employer l'un ou l'autre. Il y a enfin des dyamu réservés aux femmes. Cest ainsi que les filles des Kamara sont appelées Damba celles des Konaté, Suko celles des Sisé, Seiba.
33. Principales Sènankuya du Haut Niger, d'après Humblot, (1919, p. 532)
| Keita = Fofana |
| Kèita = Bèreté = Shérifu = Sisé |
| Kèita = Kaba = Kuyaté (leurs dyèli) |
| Kõndé = Traore, Kuruma = Kuma |
| Kuruma = Dabo |
| Kuruma = Konaté = Kamara = Bagayogo |
| Konaté = Dugunako |
| Konaté = Sidibé (Fula) |
Aubert (p. 80) donne une liste analogue pour les Bambara de Bougouni. Sur cette institution: Griaule (Africa, 1948, p. 242). Zahan (1963, p. 29).
En dehors des insultes rituelles, particulièrement lors du nouvel an (Dyombènè), l'institution entraîne l'obligation d'assistance mutuelle et de cadeaux fréquents.
34. Inversement, le lien le plus fort qui puisse unir deux personnes, le pacte du sang (dyõngè) entraîne une parenté fictive et interdit tout mariage entre les lignées des intéressés. (Sur cette institution, voir Monteil, 1924, p. 225).
align="center" 35. Telle peut être l'origine d'un véritable nom de clan. C'est ainsi que Mãsasi s'est pratiquement substitué à Kulibali dans le Kaarta.
36. On traduit généralement horõ par « noble ». Nous réservons ce terme aux lignées souveraines d'un kafu (Mãsasi) et preférons rendre horõ par « libre », en opposition aux captifs (dyõn) et aux gens de caste (nyamakala).
align="center" 37. On désigne aussi le chef de famille sous le nom de lutigi, ce qui le situe dans la hiérarchie politique et non dans le lignage. Mais ce terme est peu employé. On s'adresse toujours à lui avec le mot fa « père » (va dans ie Konyã qui est à la fois respectueux et affectueux.
38. Cette expression fort heureuse est de Pierre Alexandre (C. E. A. no. 14, p. 234). Il fait remarquer à juste titre que le premier rang dans la génération des fils est tenu par l'aîné du frère aîné, qui n'est pas forcément le plus âgé. Il s'agit sans doute d'une règle universelle pour les systèmes patrilinéaires de ce genre. En effet, chez les Malinke comme chez les Kotokoli, les fils du align="center" second frère ne passent qu'après le dernier fils du premier frère. C'est souvent l'occasion d'une scission du lu.
39. Foroba tiré de foro,« champ », désigne les biens collectifs, qu'ils soient investis au niveau d'une lignée, d'un village, d'un kafu ou d'un Empire, comme celui de Samori.
align="center" Chez les Malinké du Sud, les meubles acquis personnellement par un homme sont partagés à sa mort par ses enfants. S'il s'agit d'un lutigi, les biens familiaux s'en distinguent naturellement et reviennent au nouveau fa. Les femmes n'héritent pas, mais les captifs de case (intégrés à la famille] transmettent leurs biens à leurs enfants.
align="center" 40. Nous appelons ménages les familles nucléaires bilatérales. Le mot Malinké est gbà, c'est-à-dire foyer, que le ton bas distingue de gbá, « hangar à palabres ».
41. Cest ainsi que le fa pouvait mettre en gage ses parents ou vendre les incorrigibles, mais des décisions aussi graves exigeaient l'accord du conseil de famille
align="center" 42. Les mariages par échanges successifs de femmes entre deux lignées étaient en principe indissolubles. Très fréquents chez les Sénufo, on les trouvait chez les Bambara de l'Est, entre Baulé et Bagné, mais ils étaient pratiquement inconnus des Malinké.
43. Pris dans un sens très large, tuntigi finit par désigner en bloc l'élément animiste et guerrier par opposition aux musulmans Maninka-Mori, de même que sohõndyi s'oppose dans l'Est à silama.
align="center" 44. Les nobles ou tuntigi se distinguent, selon nous, des horõ par leur droit souverain de leur lignage sur le kafu considéré. La structure tonale interdit toute confusion entre leur nom et tõntigi (chef d'association, ci-dessous).
align="center" Selon DelaFosse, le mot vient de la racine tun « ce qui dépasse la normale ?», « notable ». Nous préférons le rattacher, avec Labouret (1934, p. 105) à tõ, carquois. Il évoquerait alors une aristocratie guerrière. On distingue en outre parmi les horõ, les Bula (Bla en Bambara), qui seraient, selon Monteil (1929, p. 316) issus des affranchis des Empereurs du Mali. Ils comporteraient douze dyamu:
| Kamara | Kuruma | Sisoko |
| Bagayogo | Kutiyoro | Sumayoro |
| Sineyoro | Tallyoro | Noya |
| Danyoro (dañyo, forgerons) | Dumbuya (= Sisoko) | Bibãmbã ( = Kamara) |
Les Finè (= Kamara) seraient les griots des Bula, ainsi que certains dyèli qualifiés de Bula-Dyèli et, en conséquence, particuliérement estimés au point d'être admis au Komo. Tous les Bula mâles peuvent être salués Susogo et les filles Dãmba.
Nous avons complété la liste de Monteil par Humblot (1918, p. 527) et avec l'aide de notre informateur (6)
Les Bula dont un ancêtre, Bala Susogo, aurait ramené de la Mecque des secrets relatifs à l'initiation, fournissent des hommes de savoir supérleur, qu'ils soient forgerons, griots ou horõ. Dans de nombreux kafu de la région
considérée, ils sont eux-mêmes tuntigi ou, comme on dit parfois, sijramogho. Ce dernier nom signifie, hommes de la route, et est de formation analogue à siiramagã ou siratigi (Siratique), titre royal sur le Sénégal. Ces « hommes de la route » sont maîtres du pays et peuvent donc faire payer les étrangers pour les laisser passer. Originellement, ce nom désigne cependant les chefs d'initiation des Peuls et le chemin dont ils sont maîtres est d'ordre mystique (Ba et Dieterlen, 1960).
45. Les Malinké ne considéraient les dyõ comme horõ qu'à partir de la quatrième génération, alors que les Forestiers ne distinguaient plus les fils de captifs nés dans le village. Ceux-ci etaient qualifiés par les Malinké de Wuluso et ne pouvaient plus être vendus, mais ne participaient pas officiellement à la vie politique. Ils jouaient en revanche un très grand rôle dans les Societég d'Initiation.
46. Nyamakala = manche du Nyama (force vitale). On ne peut suivre Monteil qui l'expliquait par Nyama = ordures. Les tons indiquent qu'il s'agit de deux racines distinctes, mais un jeu de mots n'est pas exclu.
47. Sur les dõzo, voir, en dernier lieu, Youssouf Cissé, Notes sur les Societés de chasseurs malinkés (I. S. A., 1964).
En pays animiste, les musulmans, ou mori, s'ils n'étaient pas dyula, étaient fabricants d'amulettes et guérisseurs. A ca titre, ils constituaient simplement une corporation de plus.
48. Sur toutes ces castes, on se reportera à Zahan (1965, pp 126-128). La liste confuse de Delafosse (H.S.M., III, 118) est peu utile. Les Loghõ, fondeurs de cuivre, se rencontrent seulement en pays Sénufo et dans l'ouest voltaïque.
49. Les Kulé, fréquents vers Bougouni, y sont accusés de pratiquer l'inceste.
50. Il n y a pas une caste de devins et les différentes techniques traditionnelles sont souvent utilisées par les prêtres de différents cultes, qui sont généralement des horõ (voir à ce sujet Dieterlen, 1950, p. 210).
Certains groupes de forgerons se sont pourtant spécialisés dans la géomancie (kéñyélakè) d'origine sémitique. C'est le cas des Koroko qui sont établis sur l'axe Bamako-Buguni-Odienné où ils se livrent au colportage de la kola. Ce sont d'assez pauvres gens, mais leur réputation de géomancien est très grande de Kankan jusqu'à Ségu. Binger paraît avoir été le premier à parler d'eux (1891, T. I, p. 41-42). Pour une étude assez soignée de leur technique, on se reportera à Monteil (B.C.F.H.S. AOF. 1931, p. 27-136).
51. A l'exception des Finè et Bla-Dyèli, les personnages faisant fonction de griots dans les trois sociétés d'initiation « didactiques » sont en fait des horõ (Zahan, 1965, p. 143).
Les Finè portent ordinairement le dyamu de Kamara, car ils seraient issus de ce clan. La forme bambara est funè, celle du malinké Nord fina.
52. Le meilleur exposé sur les griots manding est actuellement celui de Zahan (1965, chap. V, pp. 125-148). A titre de comparaison, on se reportera au chapitre de Lombard (1954, pp. 203-214) qui insiste avec raison sur la fonction sociale du griot en pays Bariba.
La tradition rattache chaque clan de dyèli à un clan horõ, et leur séparation fait l'objet d'un récit étiologique. L'expression « catalyseur social » est empruntée à l'étude de Smith sur les griots Hausa (Africa, 1958).
Hugo Zemp, dont les thèses s'opposent souvent à celles de Zahan, vient de publier une intéressante analyse structuraliste de la « légende dea griots malinké ». (C.E.A., 1966, p. 611-643). Il tranche l'étymologie du mot en faveur de dyèli, « sang ».
53. Dans les grandes agglomérations. comme Kankan ou Kong, chaque quartier fonctionne par contre comme un véritable village. Il possède alors une personnalité marquée et est dirigé par un vrai chef.
54. Et non au fa le plus agé qui soit issu du fondateur.
55. Les cultes agraires (dasiri) dominent dans le cadre du village dont la grande fête (dugu-sõ = sacrifice du village) a lieu au moment de la récolte (octobre-novembre) quand les divinités réclament les prémices. Nous verrons que la fête du kafu, dont l'esprit est plus politique que religieux, a lieu un peu plus tard, après le solstice d'hiver, pour marquer le nouvel an.
Pour les cultes et rites villageois, on pourra se reporter à Dieterlen (1950, p. 128-209). Bien que cette description concerne au premier chef les Bambara du Niger, elle nous a paru largement valable pour les Malinké du Sud.
56. Le dugutigi ne dispose que d'un seul agent officiel, le wèlè-laala ou crieur public qui proclame les décisions et nouvelles en les scandant à l'aide d'une clochette (wèlè dans le Konyã).
57. Meillassoux (1963) relève ainsi un véritable contre-sens chez Monteil (1924/CE.A. no. 14. p. 215)
Leynaud (1966) donne une bonne description des tõ et de leurs rapports avec les Kari. Cet article est un extrait de sa thése du 3ème cycle sur les structures sociales du Bas Manding (1967).
58. L'étude des dyõ est jalonnée par les livres de Henry (1913), Monteil (1932), Tauxier (1927). Dieterlen (1952), Zahan (1960).
Les cases contenant le matériel des societés sont construites un peu en dehors du village. Les retraites d'initiation se font dans un « bois sacré » tout proche.
59. Sur ces masques. Goldwater, Bambara Sculpture (1960).
60. Zahan, 1960, p. 31-32, 1963, pp. 144-45.
Zahan met à part le Komo, le Kono et le Nama qui sont des sociétés didactiques caracterisées par l'usage d'un mirliton (ware-da = bouche de fauve) et de faux griots.
Les trois autres sociétés mettent en œuvre respectivement:
D'après la carte de Zahan, le Baninko est la seule région où la plupart des villages possèdent un Korè. On en trouve aussi un grand nombre chez les Malinké de Kangaba et du Sãnkarani, c'est-à-dire au cœur de l'ancien Empire du Mali.
61. Les dyo fonctionnaient encore en 1958 à Nora, à cent kilomètres en amont de Siguirl. Le Korè paraissait cependant y être inconnu.
62. Les traditions relatives à leur institution par Mãsa Musa, qui les aurait ramenées de la Mecque au XIVme siècle, peuvent s'expliquer si l'on admet que l'Empereur fit un effort pour les contrôler et les utiliser au profit de son autorité. Il est possible que ce siècle, où la civilisation néo-soudanaise du Mali était à son apogée, ait vu un renouvellement profond des Sociétés et que celles-ci se soient alors cristalliséss dans des formes proches de celles que nous connaissons.
63. La meilleure description du Nya dans Monteil (1932, pp. 138, 142). Cet auteur n'insiste pas assez sur la localisation des six dyo, qui n'atteignent guère la région de Dienné. Selon R. Colin, il prend le nom de wara = fauve, chez les Sénufo de Sikasso.
64. Le Djo a été décrit par V. Paques, J. S. A.. 1955). Certains de ses éléments évoquent le Korè. Ses initiés, les plus actifs, les Kolo-Duga ressemblent beaucoup aux Koré-Duga.
65. Le Nkényé, le Ntokofa, la Dyõmburu et le Boso. Le second, connu sous le nom de Ndako paraissait seul actif dans le Torõ d'Odienné en 1962.
Il est significatif que les Sénufo, pratiquant le Porô soient les seuls qui portent des dyamu originaux et non des formes manding comme ceux des zones à Djo et Nya.
66. Ils sont munis de fusils de bois et jouent aux chasseurs. Dans les chants qui accompagnent leurs danses, ils inversent systématiquement certaines syllabes.
67. D. Zahan signale dans le Djo des éléments appartenant à la fois au Tyiwara, au Nama et au Komo (1960, p. 31). Les Koloduga des Fula du Gwana et du Girila (centre de Beyla) se voyaient encore vers 1940.
68. Le culte sera interrompu au Bana, mais ce sera du fait de la révolte de 1885, qui laissera le pays dépeuplé et non en raison de persécutions religieuses. Les habitants reviendront en 1894, aprés l'occupation de Bougouni par les Français.
69. Cet effacement est progressif. C'est ainsi que le Ntomo et le Nama existent encore dans le Wasulu, le Ntomo seul dans le Sankarã et le Kuranko.
70. Pour le Komo bambara, en attendant les étude annoncées par D. Zahan, la meilleure description reste celle de Labouret (1934, pp. 74-95).
71. La couleur rouge, qui était celle de l'Empereur du Mali et demeure celle du Komo, détermine le choix des animaux sacrifiés. La case, isolée dans un bosquet à quelques centaines de mètres du village, se reconnaît à un pignon triangulaire évoquant la face du génie. Les masques komo du Mau ont un visage en losange dont le menton se prolonge par un bec busqué très long. Ils rappellent le masque « grand calso » de la région de Man. B. Holas en reproduit un, de type un peu différent (1960, p 53).
Dans la région de Beyla, il y avait jadis un masque facial plat et rond qui portait le nom de koko. Il dirigeait le travail collectif des jeunes gens si bien que les Tõ-Dén prenaient le nom de Koko-Dén.
72. Chez les Kuranko de Guinée, les derniers Komo ont été brûlés en 1959 sur l'ordre du P.D.G. L'institution s'était éteinte au Sankarã et au Konyã vers 1950.
73. L'acte de circoncire ou d'exciser se dit boliko dans l'ensemble du monde manding. Le rituel porte le nom de biri en Pays Kurãnko et les auteurs britanniques ont étendu ce nom à l'ensemble de la société du Komo. Ils n'ont d'ailleurs décrit ce rituel que très sommairement et utilisent des termes énigmatiques pour l'initiation des garçons (gbangbami, andomba) et celle des filles (kambam, dont le sens possible est « épaule », sègèrè). McCulloch (1950, p. 92).
74. Chez les Manding, comme les Sénufo, les scarifications les plus fréquentes sont des cicatrices verticales, plus ou moins longues, en nombre variable, mais rarement plus de quatre par joue, orientées de la commissure des lèvres à la tempe. Chez les Manding, où elles sont au nombre de trois et s'allongent sur toute la face, elles permettent de distinguer les animistes, et particulièrement les familles nobles . Les lignées musulmanes n'en portent jamais. Celles des paléonégritiques sont d'une complication et d'une étendue remarquables, alors que les Forestiers les réduisaient à presque rien. Quant aux scarifications diverses qui parsèment le corps, elles sont diverses et très variables. Dans les pays de la Forêt (Schwab. 178-720 et Paulme, 1954. p. 58), elles sont liées à l'initiation.
Les déformations sont exceptionnelles, en dehors de la perforation des oreilles, des narines et de la cloison du nez en vue de fixer les bijoux. Celle-ci est générale et particulièrement fréquente chez les Bambara. Le percement de la lèvre inférieure pour y insérer un labret métallique ou en quartz, est par contre propre aux Voltaïques et très courante parmi les Sénufo. Ces traditions cosmétiques n'ont rien à voir avec l'initiation, non plus que les mutilations dentaires, exclusivement masculines, qui sont effectuées dès que la dentition définitive est en place. Celles-ci sont justifiées de façon pseudo-rationnelle, par exemple par le désir de rendre les hommes séduisants aux yeux des femmes. Elles sont généralement limitées aux incisives supérieures, limées en pointe (Kisi, Dã, Guro, Konyã, Bambara). Voir en dernier lieu Zahan (1963, p. 36-37).
75. Dans tous les pays Malinké du Sud, la société d'initiation féminine, homologue du komo, est le Nyagwa, sur lequel nous n'avons aucun renseignement.
76. Sur le komo en pays Kisi, on se reportera à A. Schaeffner. Les rites de circoncision en pays Kisi (Etudes Guinéennes, n° 12, 1953, pp. 3-56. Mise au point de B. Holas, id. n° 13, 1955. p. 60-67) Voir aussi B. Holas. Le masque komo de Korodou (N. A. no. 38, avril 1948) et La circoncision dans le pays Kisi (Acta Tropica, vol. 6, no. 4, Bâle, 1949).
77. Rappelons que nous distinguons les Konor, sous-ethnie Kpèllè (Nzèrèkorè) et les Kono, qui sont des Manding de Sierra Leone. En pays Konor, on trouve le komo uniquement dans le canton Sauro, au contact des Konyãnké du Karagwa. Holas (1952) en reproduit un exemplaire, comparable à celui qu'il nous a été donné de voir au Mau, mais dépourvu du bec busqué qui en prolonge la face vers le bas.
78. Une étude approfondie de cette société serait nécessaire. Sa familiarité avec le feu évoque les tatugula-wa du Korè (Zahan, 1960).
79. La longueur du u distingue clairement
suubagha = sorcier
subagha = prière islamique de l'aube.
Les sorciers exercent la magie noire au moyen du korti qui est un ensemble de procédés maléfiques nuisant physiquement ou moralement à l'ennemi (Monteil 1924, pp. 142-52) (Zahan, 1963, p. 123). Leurs pouvoirs sont héréditaires ou acquis
80. Le gwasa est préparé avec de la cendre du samaworo (une liane épineuse poussant en buissons) et d'écorce do siri (Burkea africana).
81. Son nom konor est Zagbiné. L'un d'eux est reproduit par B. Holas (1952), p. 46. Celui que nous avons observé au village musulman de Koro était du même type.
82. C'est le Nyomu Kwuya des Konor dont la meilleure description se trouve chez Holas (1952. p. 110).
83. Roland Colin l'a observé en 1952 dans le Ganadugu méridional (cercle de Sikasso). Il y donne de véritables spectacles payants et visite les circoncis. Chez les Malinké de Séguéla comme chez les Konor, ces masques sortent par deux, les échasses du premier mesurant bien deux mètres et celles du second, moitié moins.
84. Pour la religion des Kono, on se reportera au livre, malheureusement médiocre de Parsons (1964). Pour les Limba, autres voisins des Kurãnko, voir Finnegan (1965).
85. Le Porõ est inconnu des Dã, ce qui leur donne, selon Himmelheber un véritable complexe d'infériorité (1958, p. 19). Ce peuple possède des masques « achetés » aux Mano dont ils parlent toujours la langue. Pour une étude des Porõ, voir Schwab (1947, pp. 267-268).
86. Chez les Kisi, toujours divers et particularistes, la situation est complexe. Dans la zone nord ou règne le komo, l'initiation est centrée sur la circoncision et l'excision, qui partagent le nom de biri ou birila, la seconde étant cependant parfois baptisée sambélé. Le rituel évoque celui des Kurãnko.
Dans le Sud-Est, pays d'influence toma, le schéma forestier s'impose. La société d'initiation masculine, qualifiée de Toma n'est qu'un avatar du Porõ. Sa correspondante féminine, le Bundo, est une variante du Bundé.
Dans le Sud-Ouest où la civilisation kisi garde la plus grande originalité, l'initiation des garçons est assurée par la société Sokuno qui s'écarte de la norme du Porõ, mais le Sãndèndo des filles est une variante du Sãnda
87. Pour les Sénufo, lo est simplement la traduction en dyula du nom du Porõ. L'institution du Worodugu présente cependant des originalités et peut-être des archaïsmes qui mériteraient une étude spéciale. Les derniers Komo du Worodugu ont disparu vers 1956 alors que le lo vivait encore dans certains villages en 1959, malgré les protestations violentes des minorités musulmanes. Il comprend trois masques sculptés, le Gbõ, voisin de celui du Djo d'Odienné, et les deux Duganigbè (petit vautour blanc) qui sont de style guro (masques faciaux anthropozoomorphes). Ils sont généralement achetés en pays Guro. Tous les autres « fonctionnaires » de l'initiation, les Sènikè-dyugu, sont revêtus de cagoules à dessins variés qui évoquent les agents du Porõ Sénufo. Les Bèmbakutu (grand-père rond) sont vêtus de collants noirs (rayés pour le masque dit Daga-Dyata: la poterie lion) et leur tête disparaît sous un cône de fibres végétales descendant jusqu'aux épaules. Le Katrè, vêtu de la même façon, mais orné de plaques métalliques, sort de temps à autre la nuit pour rétablir l'ordre.
88. Pour ces déformations de l'Islam, voir ci-dessous section D.
La tradition des Dyula de l'Est a été constituée à Kong, en milieu Sénufo, mais elle a subi dans le Nord l'influence des Bobo et des Bolõ d'Orodara (Haute Volta, à présent Burkina Faso). Ceux-ci sont des Bambara exclusivement animistes mais leurs coutumes d'initiation paraissent fortement contaminées par celles des Bwa (Bobo-Ulé) Leur lo est peut-être à l'origine de celui des « Dyula » de l'Est (Jacquinod, B.I.F.A.N.. 1963).
89. Les hommes-panthères (sans parler des hommes-crocodiles, plus rares) se rencontrent chez tous les Forestiers, Kono, Kisi, Toma, Guerzé et Dã. Chez la plupart d'entre eux l'anthropophagie est rituelle, liée à des cultes secrets. Cependant, elle paraît avoir connu un développement considérable chez les Manõ et Da du Sud. Les Dã du Nord et les Guro la nient par contre avec horreur. Cf. Schwab, 1947, p. 370.
Il est possible que les Sénufo aient connu jadis une anthropologie rituelle (Holas, 1955).
Le sacrifice humain était par contre assez commun chez les Manding (Monteil, 1924).
90. Political Function of the Porõ : Africa, 1965, n° 4 et 1966. n° 1.
91. Le Dyo du village principal, celui qui a « vendu » le rite aux autres, voit sa prééminence reconnue par toutes ses filiales. Il y a là un élément de centralisation qui peut-être exploité politiquement.
92. A titre de comparaison, on se reportera au livre admirable de Ch. Monteil sur les Khasonké (1915). Cette monographie d'un groupe Fula nous donne une vue précise d'un autre faciès manding où le kafu a perdu toute importance, écrasé entre l'autonomie vivace des villages et la rude hégémonie guerrière des Fankamala (= Faama) du clan Dyallo.
93. Labouret (1934), pp. 43 à 46. La description la plus détaillée de l'organisation politique d'un kafu Bambara se trouve dans Le coutumier de Bougouni par A. Aubert (Paris, 1939). On lui reprochera seulement de donner un exposé abstrait et trop systématique, sans tenir compte des faciès régionaux dont l'existence n'est pas douteuse.
94. Dans les centres importants, il y avait un petit marché quotidien de produits vivriers (Kankan, Odienné, Wolosébugu). Dans tout le monde malinké et bambara, la semaine porte le nom de « tête du marché » = logho-kun. Elle est également de sept jours chez les Forestiers du Nord (Toma, Dã, Guro), mais seulement de cinq plus au Sud et chez les Sénufo. Quant aux Kisi et à certains Guro, dans l'Est, ils n'avaient traditionnellement aucun marché ; le commerce, très faible, était assuré par des colporteurs faisant du porte à porte.
95. Mon analyse diffère fondamentalement de celle de Leynaud (1957, pp. 99 à 103) car celui-ci refuse la qualité d'Etat au kafu, qu'il juge fondé sur les relations lignagères avec une « structure en tous points semblable à celle du village ». Cet auteur a le tort de ne voir d'Etat que là où il y a centralisation issue d'une conquête.
96. La succession en Z parait dominer dans les kafu du Banã et du Baninko. Aubert a sans doute tort de l'étendre à tous les Bambara (p. 9). Cet auteur paraît d'ailleurs se contredire page 10 en écrivant que le nouveau Faama fixe le lieu de sa résidence, ce qui n'a aucun sens s'il doit être choisi dans une seule lignée.
97. De telles rotations sont fréquentes à travers l'Afrique occidentale, mais les éléments sont en nombre variable, deux par exemple chez les Limba (Finnegan, 1964) ou bien chez les Abro, mais souvent trois dans le monde voltaïque, comme c'est le cas à Bouna. Le rythme ternaire paraît bien établi chez les Malinké, au point que l'extinction d'une branche a souvent entraîné la scission de l'une des suivantes. On pourrait cependant signaler des cas d'alternances quaternaires. En dernier lieu voir Goody (1956),
98. Tel est le cas dans le Dyuma, qui fera l'objet d'une étude spéciale.
99. Je fais abstraction, bien entendu, des commandements militaires fondés en terre Sénufo par des Manding ou sous leur influence (Kénédugu, Ngèlé, Korhogo, Sinématyali).
100. Le chef du kafu étant presque toujours un lutigi, il prend le pouvoir à un âge généralement assez élevé et règne peu de temps. Nous avons donc une série de successions assez nombreuses réparties entre trois lignages majeurs et un nombre indéterminé de lu (= lignage minimal), parfois enfin entre plusieurs villages.
Ceci explique l'impossibilité où on se trouve de dresser les listes des chefs de kafu qui remonte au-delà du début du XIXme siècle (dans la meilleure hypothèse). Cela ne signifie pas qu'on ne connaisse aucun nom plus ancien, mais il n'est pas possible de les insérer dans une série continue.
Le sens généalogique des Malinké de lignée noble, nous guide facilement jusqu'au XVlme siècle et souvent jusqu'au XVIme (à 30 ans par génération) mais il ne nous est ici d'aucun secours. Les traditions ne conservent le nom des anciens chefs que dans la mesure où leurs descendants ont amorcé la segmentation progressive du lignage. Si ce n'est pas le cas, s'il s'agit par exemple d'un guerrier célèbre qui n'était pas forcément Mãsa, et qui n'a pas laissé de descendance, il arrive qu'on soit incapable de le situer sur la généalogie. Il arrive aussi qu'un ancêtre de lignée n'ait été qu'un simple lutigi mais que ses descendants affirment avec véhémence qu'il était un Mãsa.
Enfin, une fois établie une série de noms anciens, il est difficile de les insérer dans une chronologie relative, car les traditions des lignages alternants sont absolument indépendantes et n'offrent pas toujours des recoupements.
Il paraît donc actuellement impossible de reconstruire l'histoire des Malinké aux XVIIme et XVlIme siècles en partant des listes de chefs. Si nous renonçons à serrer de trop près la succession des souverains, les généalogies nous offrent par contre un cadre admirable.
Meillassoux paraît s'être heurté à cette difficulté. Il est regrettable qu'il ne nous donne qu'un schéma appauvri des généalogies de Bamako, alors que sa liste des Faama remonte péniblement jusqu'à la fin du XVIIIme siècle (C.E.A., 1964, n° 14, pp. 201-202).
101. «Sur toute l'étendue du royaume de ce souverain, nul ne porte le titre de roi que le souverain de Gana. » (sans doute Tunka) (Al Omari, p. 59).
102. Farba vient de Faarin-Ba (Grand brave). Le Tarikh es Sudan et le Tarikh el Fettach, rédigés dans un milieu de langue Songhay, traduisent Faarin par Koy. Voir à ce sujet Pageard, 1961. On ne désignait pas autrement les rois Dyawara (Boyer, 1956).
Les dignitaires ou ministres du Mali portaient le titre de Farma que Delafosse expliqué par Faarin-Magã ou seigneur des Faarin. Ce nom évoque certainement un ancien droit d'investiture. Il est par contre phonétiquement impossible que Farma ait donné Faama.
103. C'est ainsi qu'au XVme siècle, le représentant de l'Empereur en Gambie portait le nom de Bati-Mãsa, et son voisin du Sud celui de Kasa-Mâsa, d'où dérive Casamance (V. Fernandes, 1951).
104. Une telle dévaluation d'un titre prestigieux chez des allogènes qui l'ont adapté par snobisme n'a rien de surprenant. Nous la retrouvons dans l'emploi que font les Susu et Témnè, fraîchement islamisés, des titres d'Almami et Alkali (Al Kadi) empruntés au Fuuta-Dyalõ. Chez les premiers, Almami a supplanté le titre traditionnel de Mãnga, qui dérive de la même racine que Mãsa.
105. Delafosse distingue les racines mã ou maa (1955, p. 479) et magã ou maa (1955, p. 493). Toutes deux ayant à peu près la même valeur sémantique, il est difficile d'accepter ce point de vue. La disparition du g intervocalique est un accident constant en Manding.
Mgr. Molin (1955) lui donne le sens de « maître de personnes » et en dérive Maaba, Maatigi = Dieu.
Faama est une contraction de Fãgama, dérivé de Fãghaã = puissance, force, pouvoir (Delafosse, 1955, p. 176). C'est par pure fantaisie qu'on a voulu y voir le préfixe fa = père.
106. Chez les Bambara, la position sémantique de ces deux mots s'inverse. C'est ainsi qu'à Ségou, selon Meillassoux, quand Ngolo Dyara obligea les notables à lui jurer fidélité par le dégé, les Todyo auraient déclaré : « Ce n'est plus un Mãsa que nous avons, mais un Faama. » Dans le cas présent, ils voulaient dire: « Ce n'est qu'un chef guerrier, pair parmi ses pairs, que nous avons, mais un souverain héréditaire et civil » (1963, p. 217). Le souverain de Bamako portait effectivement le titre de Faama comme la plupart des chefs Bambara.
Mãsa fait d'ailleurs figure de nom propre chez certaines lignées souveraines comme celle du Kaarta qui a substitué Mãsasi à l'ancien Dyamu de Kulibali.
Nous ignorons évidemment quel titre pouvaient porter il y a plus d'un millier d'années, les chefs des lignées manding, avant la cristallisation des Empires soudanais. Mãsa peut bien avoir signifié initialement l'homme fort, le dominateur et n'avoir pris une couleur de légitimité traditionnelle, chez les Malinké, qu'après les siècles de vie réglée sous l'autorité des Empereurs. Les conquérants des terres du Sud et les auteurs du morcellement de l'Empire lui auraient conservé ce sens second. Dès lors, Faama se serait constitué normalement, pour signifier le dominateur et combler le vide créé par la dérive sémantique de Mãsa.
Inversement, on peut admettre que les Bambara, qui étaient extérieurs aux centres du pouvoir malien et en subissaient la contrainte, aient conservé à Mãsa le sens de dominateur. Je suis par contre incapable d'expliquer comment Faama a pris chez eux la valeur de chef civil et coutumier. Le fait est d'ailleurs contesté par certains informateurs et il mériterait une enquête systématique.
On ne doit en tout cas jamais oublier que Bambara et Malinké ne sont pas deux langues, mais deux dialectes de la même langue et que les innovations lexicologiques, sinon phonétiques, passent facilement de l'un à l'autre. Le cas de ces deux mots est donc fort surprenant.
107. bembé = lieu de rencontre (ben), c'est-à-dire d'audience. Telle est du moins l'étymologie de Delafosse (1955, p. 44), qui n'hésite pas à se contredire en expliquant un peu plus haut bãmba-lè: « terre-plein » par la racine bãmba = appui ?> terre-plein sur lequel s'appuie un bâtiment (1955, p. 29). Il est évident qu'il s'agit du même mot qui se prononce bãmba en pays Bambara et bembé chez les Malinké. Il désigne le terre-plein rituel sur lequel siège le chef. El Omari atteste qu'au XIVme siècle, le trône de l'Empereur du Mali y était placé (Masalik. p 65).
On emploie le mot bembelé pour désigner le gbé couvrant le bembé, et abritant les notables pendant l'audience. Voir aussi V. Paques (1953).
108. Le Mãsa était généralement enterré dans la concession royale.
109. Chez les Bambara du Sud, selon Aubert, (p. 9), l'élection se faisait, en cas de partage, par assis et levés, sous la présidence, du Tuñtigi le plus ancien. La proclamation avait toujours lieu à l'unanimité. Les électeurs discutaient aussi longtemps qu'il fallait, à l'écart de la foule, pour obtenir ce résultat.
110. Le nouveau Mãsa rendait généralement un hommage symbolique au chef de la terre, s'il y en avait un. Au Konyã, où il n'y en avait pas, l'intronisation était présidée par le gardien des tombes communes au lignage majeur.
111. La hache de commandement était généralement placée dans une gaine en peau de chat sauvage. La composition des autres Régalia était extrêmement variable. Ils comprenaient souvent
Le chasse-mouches des chefs était une queue d'éléphant et aucun subordonné n'aurait osé en user en présence du Mãsa. Il ne s'agissait pourtant pas d'un regalium proprement dit, non plus que la peau de boeuf sur laquelle le souverain siégeait désormais. Celle-ci évoquait son pouvoir personnel puisqu'elle était enterrée avec lui. Les sièges bas, chers aux notables, n'avaient aucune valeur symbolique.
112. saghalé (bambara: saalé) dériverait de l'arabe as‘ar. S'agit-il encore d'un souvenir de l'administration du Mali. Aubert (p. 11) écrit que tout l'or revenait au Mãsa. C'est là un malentendu car il avait seulement droit de préemption sur le produit des orpailleurs.
113. Les taxes de marchés et usuru étaient également perçues au niveau des villages, qui reversaient alors au Mãsa les deux tiers ou la moitié du produit.
114. Les Somono versaient aussi le dixième du produit de leur pêche. En pays d'élevage, les Fula payaient à la fois sur leur récolte et leur bétail. Ceux du Haut Konyã (Gwana Girila) donnaient au troupeau du Mãsa le dixième du croit annuel. Ce troupeau était lui-même gardé par des Fula qui avaient droit à tout le lait et au dixième du croit. Ces éleveurs étaient connus pour les fraudes diverses qui leur permettaient d'éluder ce fardeau contrairement aux cultivateurs.
115. Le lion étant connu seulement de Siguiri à Bougouni, nous ne parlons que des peaux de panthères. Le refus de les remettre au Mãsa eut été un défi à sa souveraineté, mais il ne s'agissait pas de Régalia car elles étaient enterrées avec lui.
Les redevances des chasseurs, comme les prémices dues aux chefs de la terre, portent le nom de buñya que Delafosse traduit par accroissement, hommage (1955, II, p. 67).
116. Selon Delafosse, kõsõ désigne « ce qu'on ne doit pas toucher » (1955, p. 383). En pays Kurãnko, ce terme s'est substitué à saghalé. Il signifie communément contribution de guerre, ce qui explique cette dérive sémantique.
117. Pour la procédure bambara, fondée sur le serment, et pour l'échelle des peines (mort, fers, forte amende en cauris ou bétail, confiscation de la famille, des biens, vente comme captif) on se reportera à Aubert, pp. 20-34. Cette échelle diffère peu de celle du Konyã que Samori adoptera.
La réduction en captivité était prononcée pour viol, vol par effraction, adultère hors du village ou avec une épouse du Faama, profanation de tombe (à fins de sorcellerie). La peine de mort était finalement rare (incendie ayant entraîné la mort, réunions secrètes, vol d'or, sorcellerie, usurpation de pouvoirs, empoisonnement, meurtres, avortements). Les parents des meurtriers et voleurs d'or étaient vendus. La sévérité envers les incendiaires va de soi dans un pays de toits de chaume.
Les ordalies, particulièrement celle du fer rouge, sont très fréquentes dans la région. Caillié les signale même en milieu musulman, à Kankan (I, p. 405). Il est surprenant qu'Aubert affirme le contraire.
118. Dyombènè, c'est-à-dire réunion des esclaves. Lors de cette grande assemblée des sacrifices sont toujours effectués. C'étaient jadis des sacrifices humains.
119. Il y a des exceptions, comme le chef du Ganadugu (Fula de Sikasso) qu'on appelle N'Tèri : mon ami (selon R. Colin).
120. Selon Meillassoux (1965), ce conseil officieux s'appelle à Bamako, dyé-nyogho, mot à mot : réunion des camarades. Je ne crois pas qu'il existe un nom particulier pour le désigner chez les Malinké du Sud sinon celui de laadili-la (séance d'avis) dérivé de l'arabe.
Il siège généralement dans le bolõ (vestibule) ou dans la cour de la concession (lu-kènè;).
121. C'est elle, évidemment, que les gens qualifient de Kyèbo (Meillassoux, 1964. p. 218). Cette expression est inusitée en pays malinké.
122. Une fois de plus Delafosse erre étrangement à la recherche d'une étymologie. Il songe à l'arabe diwan pour dyamaana alors qu'en haut de la même page, il suggère une étymologie correcte pour dyamaa = groupe, réunion (1955, p. 152).
123. furu ou foro, futu en Malinké occidental, désigne les champs communs et par extension les biens communs par opposition à ceux des foyers, dans le cadre d'un lu, des lu dans le cadre d'un village, des villages dans le cadre du kafu. (Delafosse, 1955, p. 219) Monteil (1924, p. 297) confond à tort cette racine avec celle de furu, mariage (Delafosse, op. cit., p. 232). Le foroba de Samori nous retiendra longuement
124. L'étymologie de ce mot sera discutée dans le chapitre traitant de l'Armée. Sofa ne peut signifier « père du village. » La structure tonale s'y oppose. Cavalier se dit sotigi. L'une des premières tâches des gardes des Mãsa, dont les sofa sont issus, était de s'occuper des chevaux de leur maître, dans un pays où ces animaux sont rares.
126. Les villages des Sénufo Nafãmbélé (Nafagha) Mali médiéval, si nous suivons Monteil (1929).
127. Les villages des Sénufo Nafagha sont d'ailleurs également minuscules.
128. Les Toma connaissent les cadeaux périodiques, les frais de justice et les prélèvements des chasseurs, mais non la ponction régulière sur les récoltes. Leurs chefs répartissaient cependant le prix des guerres entre les villages, mais il s'agissait là de charges extraordinaires.
129. Il existe des biens de chefferie (foroba) chez les Dyalõnké du Ményè (cercle de Siguiri), du Baléya (Kouroussa), du Firiya et du Solimana (Faranah). Nous n'avons aucun renseignement sur ceux du Mali (Kolo, cercle de Kita) ni du Fuuta-Dyalõ; (Sangalan de Labé).
130. Nous citerons comme cas limite le kafu kurãnko de Démbayara (cercle de Kissidougou), qui comptait 4 villages et 600 habitants en 1956.
131. Certains cantons kisi n'en ont que 200 ou 300.
132. 28 ou 30 selon les limites exactes que l'on donne au Torô.
133. Certains étendent d'ailleurs ce nom aux Malinké du Tukoro (Macenta et Liberia) dont les sept kafu sont également d'origine Kamara. Le Gbé et le Mau (Côte d'Ivoire) sont par contre toujours exclus, car ils représentent la branche aînée des Kamara par opposition aux Férén-Kamãsi.
134. Delafosse est le premier à signaler ce problème, en le simplifiant excessivement (H.S.N.. III, p. 134).
135. L'histoire des pays du Haut Niger depuis la fin du Moyen Age doit faire l'objet d'un essai de reconstruction dans un prochain travail.
136. Nous croyons avoir montré, dans un précédent article, que le Haut Niger était connu par un nom kisi jusqu'au début du XVIme siècle (N.A., 1958, p. 46). Si nous parlons d'ancêtres linguistiques c'est que nous sommes convaincus que la pénétration des Mandé du Sud et de l'Est en pays forestiers, au cours des derniers siècles a été marquée non seulement par une acculturation profonde au nouveau milieu, mais par un métissage massif avec 'es anciens Forestiers du type Kisi ou Kru. Les Toma, Guerzé, Dã ou Guro modernes sont donc le produit d'une synthèse originale effectuée dans leur terroir actuel et ne se rattachent que partiellement aux anciennes ethnies du Nord, même si leur langue en dérive directement.
Nous savons que des peuples Kru tenaient au moins le triangle Man-Touba-Séguéla. On en retrouve une fraction isolée à Orodara en Haute Volta. Voir à ce sujet notre article (Person, 1966).
137. Si leur position linguistique est bien telle que la présente Welmers (1958) ils ont dû, à une époque bien plus ancienne, être en contact avec les Samogho, quelque part entre Bougouni et Sikasso. Les traditions ne peuvent évidemment rien nous apprendre sur un passé aussi lointain. La parole est à l'archéologie.
138. Ce qui ne signifie pas, bien entendu qu'il s'agisse des « tribu » Sénufo actuelles. Celles-ci ne s'étaient sans doute pas encore cristallisées.
139. Il s'agit du Torõ occidental, entre Milo et Sãnkarani (cercle de Kankan). Le Torõ oriental (cercle d'Odienné) est issu d'une migration bambara de la fin du XVlIme siècle (datation généalogique).
Les colonies du Haut Niger ont sans doute reconnu très vaguement la suzeraineté du Mali jusqu'à la fin du XVIme siècle. Nous en avons la preuve si le « Sankar Zuma » que mentionne le Tarikh-es Sudan à propos de l'échec du Mali devant Djenné, en 1599, était bien le gouverneur, ou souverain, du Sankar. (T.e.S p. 274).
140. On soupçonne que d'autres se fondirent également chez les Forestiers.
141. Cette seconde vague a emporté sans aucun doute des éléments de la première qui commençaient à se stabiliser. On soupçonne qu'ils furent particulièrement nombreux au sein des Kono et des Vaï
142. Les Kèita paraissent avoir joué un moment un rôle dirigeant, mais ils furent vite supplantés par les Kamara. Des chefs Kamara s'imposèrent à plusieurs pays Dyalõnké depuis le Buré et le Baléya jusqu'au Firiya (Faranah).
142b. On peut admettre que les Guro traversèrent alors la région de Séguéla (Worodugu) pour gagner leur habitat actuel ou du moins ses marches du Nord. Ils laissèrent en tout cas le Worodugu aux mains de groupes Kru, ancêtres des Wobè, puisque les Malinké les y trouveront un peu plus tard.
143. Les Konyãnké profitèrent de l'irruption des Kurãnko pour commercer avec le Sierra Leone à travers le territoire ainsi dégagé. Ils reçurent de leurs nouveaux voisins le nom de Bakwa : « gens de derrière le fleuve », qui allait être reporté sur les Samoriens.
Les Lélé ne sont qu'une avant-garde Kurãnko mais si fortement métissée de Kisi que sa culture matérielle est devenue méconnaissable.
144. Cette expansion sera le fait des Sakuraka, une lignée Kamara issue du Haut Konyã qui s'imposa à ses cousins du Mau, visiblement décadents. vers le milieu du XVIIIme siècle.
145. C'est aussi à ce moment que des lignées Fula venues du Wasulu ou du Fuuta-Dyalõ ont noyauté la région de Kankan, de larges régions du Torõ et surtout le Haut Konyã où elles allaient prospérer de façon remarquable.
[Home | Bibliothèque | Histoire | Recherche | Aser | Bambara | Bambugu | Bozo Jakhanke | Jalonke | Jawara
Kagoro | Kasonke Konyanke | Koranko | Lele | Maninka | Marka | Mau | Mikifore | Nono
Sankaran | Sidyanka | Soninke | Susu | Toronka | Wasulunka ]
Contact :
webMande, webAfriqa, webPulaaku, webFuuta, webCôte, webForêt,
webGuinée, Camp Boiro Memorial, afriXML, BlogGuinée. © 1997-2013. Afriq Access & . All rights reserved.
Fulbright Scholar. Rockefeller Foundation Fellow. Internet Society Pioneer. Smithsonian Research Associate.